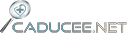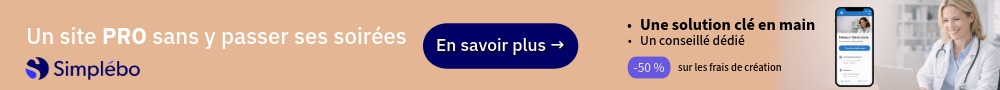Vaccination ARNm pendant la grossesse : aucun excès de mortinaissances ni de malformations, selon EPI-PHARE

L’article « First-Trimester mRNA COVID-19 Vaccination and Risk of Major Congenital Anomalies » analyse toutes les naissances vivantes en France issues de grossesses débutées entre le 1ᵉʳ avril 2021 et le 31 janvier 2022, avec suivi jusqu’en décembre 2024, via le registre Mère-Enfant EPI-MERES (SNDS). L’exposition est définie par au moins une dose d’un vaccin ARNm au 1er trimestre. Le critère principal est la survenue de MCM selon la classification EUROCAT, évaluées globalement, par 13 systèmes d’organes et pour 75 entités individuelles. Les auteurs ont utilisé une pondération par score de propension et plusieurs analyses de sensibilité.[1][2]
Méthode et périmètre
Source de données : registre EPI-MERES, imbriqué dans le SNDS (>99 % de la population couverte).[1]
Période d’inclusion : conceptions du 01/04/2021 au 31/01/2022 ; suivi jusqu’à 12/2024.[1][2]
Exposition : au moins une dose d’un vaccin ARNm entre J0 et J91 de grossesse.[1]
Analyses : régression logistique avec pondération (SMR weighting), comparaisons principales et contrôles alternatifs (vaccination aux 2ᵉ-3ᵉ trimestres, avant conception, non vaccinées jusqu’à l’accouchement).[1]
À noter : le terme « malformations congénitales » recouvre des affections très diverses, allant de la fermeture du tube neural aux cardiopathies congénitales.[1]
A propos d'EPI-PHARE et d'EPI-MERES
Créé en 2018 par l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) et la Cnam, EPI-PHARE est un groupement d’intérêt scientifique public chargé de conduire des études de pharmaco-épidémiologie à partir des données massives du Système national des données de santé (SNDS). Sa mission : éclairer les politiques publiques par des analyses rigoureuses et indépendantes. L’organisme s’est imposé comme un acteur de référence dans le suivi des médicaments et vaccins à grande échelle.
Son registre EPI-MERES, utilisé pour cette étude, constitue l’un des outils les plus puissants de la recherche périnatale en France. Il recense toutes les grossesses aboutissant à une naissance depuis 2010, relie les données mère-enfant et intègre des variables détaillées : âge gestationnel, issue de grossesse, antécédents médicaux, facteurs de mode de vie comme le tabagisme ou l’alcool. Cette exhaustivité, couvrant plus de 99 % des naissances, confère à la cohorte une robustesse rarement égalée.
Qualité et niveau de preuve
La qualité des données issues du SNDS, enrichies par EPI-MERES, repose sur un codage standardisé des malformations (EUROCAT) et une traçabilité fine de l’exposition vaccinale. Les dates exactes d’injection permettent de situer avec précision la fenêtre du premier trimestre, limitant les biais de classification.
Avec plus d’un demi-million de naissances et des analyses pondérées par score de propension, le niveau de preuve de l’étude est jugé élevé pour écarter tout sur-risque cliniquement significatif de malformations après vaccination ARNm. La cohérence interne des résultats, confirmée par de multiples analyses de sensibilité, renforce cette conclusion. Comme le rappellent les auteurs, seule une étude randomisée pourrait établir une causalité stricte, mais la constance des observations rend hautement improbable un effet tératogène non détecté.
Résultats en chiffres
Effectif : 527 564 nouveau-nés éligibles ; 130 338 exposés (24,7 %).[1][2]
Prévalence MCM : 176,6/10 000 chez les exposés (2 302 cas) vs 179,4/10 000 chez les non exposés (7 128 cas). OR pondéré global : 0,98 [0,93–1,04]. Aucun excès par système d’organes (OR pondérés de 0,84 à 1,20) ni pour aucune des 75 MCM individuelles.[1][2]
Mortinaissances : 0,4 % dans les deux groupes ; RR : 0,96 [0,87–1,05], non significatif.[1][3]
Citations traduites des auteurs
« Ces résultats suggèrent que les vaccins anti-COVID à ARNm ne présentent aucun effet tératogène apparent. »[1]
« Notre étude confirme la sécurité fœtale des vaccins à ARNm pendant la grossesse, en ne montrant aucune augmentation du risque de MCM. »[1]
« Les autorités sanitaires et les professionnels de santé devraient actualiser leurs recommandations afin que les femmes enceintes soient correctement informées. »[1]
Limites et points de vigilance
Analyse centrée sur les naissances vivantes : identification moins fiable des MCM chez mort-nés et interruptions médicales de grossesse. Toutefois, l’analyse dédiée aux mortinaissances retrouve un RR = 0,96, non significatif.[1]
Rareté de certaines MCM : puissance limitée et intervalles de confiance parfois larges malgré l’effectif. Quelques associations isolées significatives à la baisse, probablement dues au hasard statistique, sans cohérence clinique.[1]
Facteurs non mesurés possibles (ex. expositions environnementales tératogènes), d’ampleur attendue limitée au vu des variables déjà incluses.[1]
Ce qu’il faut retenir pour la pratique
Message à transmettre en consultation prénatale : absence d’association entre vaccination ARNm au 1er trimestre et MCM ; taux de mortinaissance identique. Chiffres à retenir : OR 0,98 ; 176,6 vs 179,4/10 000 ; RR 0,96.[1][3]
Continuer à prévenir les infections maternelles à risque connu d’issues fœtales sévères, à l’image de la rubéole, qui expose à des malformations congénitales graves si contractée pendant la grossesse. Faire la part des choses entre risques prouvés et peurs infondées reste la meilleure boussole.
Références
1. JAMA Network Open. First-Trimester mRNA COVID-19 Vaccination and Risk of Major Congenital Anomalies. 15 octobre 2025. Lien
2. EPI-PHARE. Vaccination COVID-19 au 1er trimestre de grossesse et risque d’anomalies congénitales majeures. 16 octobre 2025. Lien
3. CIDRAP. Study finds no link between mRNA COVID vaccines early in pregnancy and birth defects. 16–17 octobre 2025. Lien
Descripteur MESH : Grossesse , Malformations , Risque , Vaccins , Mortinaissance , Vaccination , France , Enfant , Classification , Santé , Score de propension , Sécurité , Population , Causalité , Femmes enceintes , Femmes , Expositions , Recherche , Vie , Épidémiologie , Âge gestationnel , Confiance , Tabagisme , Intervalles de confiance , Tératogènes , Mort