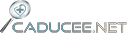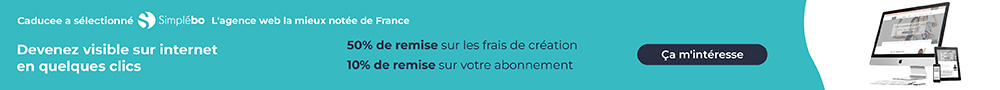Saison grippale 2024-2025 : intensité prolongée et sévérité inédite aux urgences

« Jamais observés auparavant » : le rapport insiste sur des valeurs maximales inédites pour plusieurs indicateurs hospitaliers au cœur de la vague.
Chronologie et dynamique épidémique
Pour comprendre la trajectoire de la vague, il convient d’articuler calendrier et intensité régionale avant d’en tirer les enseignements cliniques. L’épidémie démarre début décembre (S49) et toutes les régions sont en phase épidémique de fin décembre (S51) à fin février (S08). Le retour à une phase inter-épidémique est effectif début avril (S14).[1] La durée de 12 semaines dépasse la moyenne des saisons 2011-2012 à 2023-2024 (10 semaines).[1]
Charge en ville : consultations et intensité
Sur le versant ambulatoire, les indicateurs dessinent un continuum qui nourrit ensuite la pression hospitalière. Pendant l’épidémie (S49-2024 à S08-2025), 2 736 363 consultations pour syndrome grippal sont estimées, soit un taux d’incidence cumulé de 4 087/100 000 [IC95 % : 3 880–4 296]. Le pic atteint 522/100 000 [497–548] en S04-2025. L’incidence cumulée dépasse la moyenne des cinq saisons précédentes pour toutes les classes d’âge : 9 415/100 000 chez les [1]
À lire sur Caducee.net : bilan de la saison 2024-2025.
Urgences et hospitalisations : sévérité inédite des indicateurs
En miroir de l’activité de ville, l’aval hospitalier a subi un effet de ciseau, avec un signal d’alerte précoce sur les plus jeunes. Au plus fort de la vague (S01-2025), la part des hospitalisations pour grippe/SG parmi toutes les hospitalisations après passage aux urgences atteint 5,4 % tous âges, 7,9 % chez les [1] Le niveau d’intensité « très élevé » dure huit semaines chez les [1]
Contexte Caducee.net : surmortalité hebdomadaire en cours de saison.
Cas graves en réanimation
En bout de chaîne, la réanimation concentre les formes les plus sévères ; les profils et issues éclairent la prévention. Sur S40-2024 à S17-2025, 1 911 cas graves de grippe sont admis en réanimation ; 55 % d’hommes, 47 % de ≥65 ans. Un total de 279 décès est rapporté (16 %). Parmi les cas au statut vaccinal renseigné (n=1 774), 80 % n’étaient pas vaccinés, proportion qui atteint 86 % parmi les décédés. La ventilation non invasive a été utilisée chez 58 % des cas, la ventilation invasive chez 36 %, une assistance extracorporelle chez 2 %.[1]
Établissements médico-sociaux et mortalité populationnelle
Au-delà de l’hôpital, le fardeau se lit dans les EMS et dans la mortalité toutes causes, ce qui impose une lecture nuancée. Dans les EMS, 4 071 épisodes d’IRA ont été signalés durant S40-2024 à S15-2025 ; 1 955 étaient attribués à la grippe, dont 88 % pendant l’épidémie. Le pic de S01-2025 atteint 414 épisodes signalés, dont 302 grippés, « des valeurs jamais observées auparavant ».[1] À l’échelle nationale, la surmortalité toutes causes extrapolée sur les 12 semaines d’épidémie est de près de 17 600 décès, plus de 90 % concernant des ≥65 ans. Tous les décès en excès ne sont pas attribuables à la grippe.[1]
Virologie et adéquation vaccinale
La circulation virale et l’appariement vaccinal servent de boussole pour interpréter les courbes d’incidence et de sévérité. En ville, la proportion de prélèvements positifs pour un virus grippal culmine à 64 % en S05-2025, avec un taux de positivité de 48 % sur l’épisode. Les virus A(H1N1)pdm09, A(H3N2) et B/Victoria co-circulent ; 92 % des virus B identifiés appartiennent au lignage Victoria. À l’hôpital, 42 371 prélèvements (12 %) sont positifs parmi 365 879 résultats, 76 % de type A et 24 % de type B ; 86 % des virus A ne sont pas sous-typés, 2 442 A(H1N1)pdm09, 2 111 A(H3N2).[1] Sur le plan antigénique et génétique, les virus A(H1N1)pdm09 et B/Victoria sont apparentés aux souches du vaccin HN 2024-2025, tandis que A(H3N2) présente une inadéquation partielle, plus proche des souches de l’Hémisphère Sud 2025.[1]
Méthodes et limites
Les auteurs rappellent le socle méthodologique et les bornes d’interprétation. La surveillance s’appuie sur Sentinelles, IQVIA, SOS Médecins, Oscour®, CNR, réseaux Relab et Renal, données EMS, Insee et certification électronique. Les seuils d’intensité PISA/MEM reposent sur des séries de référence. L’attribution de la surmortalité est multifactorielle. Le sous-typage incomplet à l’hôpital borne certaines analyses.[1]
Points opérationnels pour les équipes de soins
En pratique, ces résultats appellent des réponses graduées et coordonnées entre ville, hôpital et EMS.
- Ajuster les capacités sur la séquence ville-urgences-réanimation lorsque l’indicateur hospitalier franchit le niveau « élevé » ; prévoir des unités à séjour court.
- Cibler la prévention et la communication : vaccination des personnes à risque et des soignants, gestes barrières. Quand « le vent tourne », mieux vaut être prêt.
- Consolider le lien ARS-établissements-ville-EMS : signalements rapides, coordination des sorties, surveillance virologique partagée.
Références
[1] Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH) n° 17, « Surveillance de la grippe en France hexagonale, saison 2024-2025 », 14 octobre 2025. Disponible en ligne : BEH 17/2025.
Descripteur MESH : France , Santé , Santé publique , Virus , Réanimation , Urgences , Mortalité , Ventilation , Saisons , Vent , Victoria , Médecins , Personnes , Lecture , Électronique , Génétique , Pression , Gestes , Communication , Risque , Vaccination , Syndrome