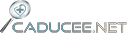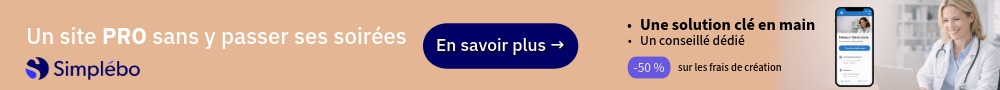Médecins retraités : l’essor du cumul révèle les fragilités du système

Un cumul d’activité en pleine expansion
Le nombre de médecins ayant choisi de cumuler retraite et activité libérale ne cesse de croître. Entre 2024 et 2025, il est passé de 13 513 à 14 285 ( 5,71 %). Contrairement aux idées reçues, ce choix ne répond pas toujours à une nécessité financière : seuls 18 % perçoivent moins de 30 000 euros par an de retraite, et 68 % bénéficient d’un montant égal ou supérieur à la moyenne nationale des retraités médecins (35 587 €).
Pourquoi les médecins prolongent leur activité
Le cumul retraite-activité est devenu un phénomène structurant de la démographie médicale. Ses raisons sont multiples :
-
Un choix personnel avant tout : nombre de praticiens souhaitent prolonger leur exercice pour rester actifs, maintenir un lien social et continuer à suivre leurs patients.
-
Un contexte réglementaire favorable : depuis 2009, le cumul n’est plus plafonné, ce qui permet aux médecins de poursuivre sans restriction de revenus.
-
Des besoins de santé persistants : certaines spécialités, comme la psychiatrie, la radiologie ou la cardiologie, connaissent une demande croissante et une démographie fragile.
-
Un complément de revenus : si ce n’est pas la motivation principale, certains médecins utilisent le cumul pour améliorer leur pouvoir d’achat ou compenser des pensions plus modestes.
Ainsi, le cumul relève bien davantage d’une logique de continuité professionnelle et d’adaptation aux besoins du système de santé que d’une contrainte purement financière.
Des profils et spécialités contrastés
Le cumul reste un phénomène largement masculin : les femmes n’y représentent que 22 %, alors qu’elles constituent 44 % des cotisants et 28 % des retraités. Sur le plan des spécialités, la médecine générale reste la plus fréquente parmi les praticiens en cumul (6 196 médecins), suivie par la psychiatrie (1 745), la radiologie (852) et la pathologie cardiovasculaire (711).
Des disparités régionales marquées
La répartition géographique illustre des contrastes notables. L’Île-de-France concentre à elle seule 4 286 médecins en cumul, soit 18,3 % des cotisants régionaux. Les proportions dépassent également 15 % en Provence-Alpes-Côte d’Azur et en Corse. À l’inverse, la région Auvergne-Rhône-Alpes, deuxième bassin médical du pays, n’enregistre que 8,7 % de médecins concernés.
Un choix de société aux répercussions sur l’offre de soins
Si la pension moyenne des médecins en cumul progresse ( 2,44 % en 2025), celle des retraités n’ayant pas repris d’activité stagne. Ce décalage souligne l’attractivité croissante du cumul, mais pose aussi la question de la dépendance du système de santé à une génération de praticiens vieillissants. Entre équilibre financier, choix personnel et besoins collectifs, la retraite des médecins libéraux apparaît aujourd’hui comme un révélateur des tensions sociales et démographiques qui traversent le monde médical.
Descripteur MESH : Médecins , Retraite , Démographie , Conjoints , Survivants , Santé , Radiologie , Psychiatrie , Cardiologie , Médecine générale , Médecine , Logique , Patients , Motivation , Femmes , Pensions , France