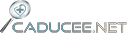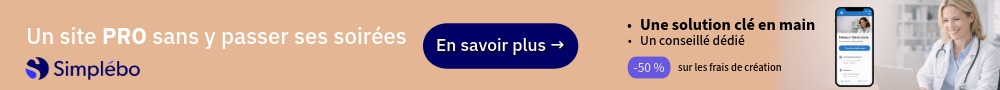Activité physique adaptée : quels résultats attendre des 24 séances du Prescri’Pass ?

Ce que disent les preuves pour les maladies chroniques
Cardio-métabolique. Le ministère indique que « la pratique régulière d’activité physique s’accompagne d’une diminution de 20 à 50 % du risque de maladie coronarienne et de près de 60 % du risque de survenue d’accident vasculaire » et qu’elle est « associée selon les études à une réduction de la mortalité précoce de 29 à 41 % »[2].
Diabète de type 2. Une méta-analyse de 125 essais randomisés rapporte qu’un « accroissement de 100 min d’activité physique par semaine était associé à une variation moyenne de −2,75 mg/dl de la glycémie à jeun […] » et, pour l’HbA1c, « une variation moyenne de −0,14 % » ; chez les sujets DT2 ou prédiabétiques, « −0,16 % » d’HbA1c[4].
Cancers. L’Inserm conclut qu’« il n’y a plus aucun doute sur cette nécessité » de prescrire une APA aux personnes atteintes de maladies chroniques et souligne que, dans les cancers, « l’activité physique apporte des bénéfices chez les patients à toutes les étapes de la maladie »[3]. Le ministère rappelle aussi des effets sur « le cancer du côlon (de l’ordre de 25 %) » et « du sein (diminution de 10 à 27 %) » en termes de risque[2].
À lire sur Caducee.net : notre décryptage sur le diabète de type 2 et un focus « parcours de formation pour prescrire des APA »[5][6].
Chez les aînés : chutes, autonomie et qualité de vie
Prévention des chutes. Le ministère précise : « Chez les personnes âgées, elle [l’activité physique] prévient les chutes et aide à rester autonome plus longtemps »[2].
Capacités fonctionnelles. L’expertise Inserm met en avant des niveaux de preuve élevés, à court et moyen termes, pour « la lombalgie chronique, l’arthrose des membres inférieurs, la polyarthrite rhumatoïde et la spondylarthrite ankylosante », avec une « bonne tolérance » observée dans les essais[3].
Santé mentale. Chez l’adulte, y compris avec comorbidités, l’Inserm signale des effets « équivalents » à un antidépresseur pour des dépressions légères à modérées dans certains essais et insiste sur des programmes « aérobie et résistance » à raison d’« un minimum de 3 séances de 30 minutes par semaine » pour des résultats tangibles[3].
Comment rendre les effets durables après 24 séances
Du protocole au quotidien. Les preuves convergent : la progression se joue autant dans la structure que dans la régularité. L’Inserm recommande un « cycle éducatif en activité physique adaptée de plusieurs mois » puis un relais vers des offres locales pour maintenir l’engagement, avec « fixation d’objectifs », « monitoring » et soutien social[3]. Autrement dit, il faut entretenir la flamme pour qu’elle ne s’étiole pas.
Repères de prescription. Calibrer l’intensité selon les limitations, viser au moins 2 à 3 séances hebdomadaires combinant aérobie et renforcement, intégrer équilibre et souplesse chez les aînés, et articuler le suivi avec le médecin traitant et la MSS. La fiche ministérielle rappelle que l’APA est une « thérapeutique non médicamenteuse » intégrée au traitement de nombreuses maladies chroniques[2].
Limites et points de vigilance
Transposabilité. Les chiffres de réduction de risque proviennent d’études hétérogènes ; ils doivent être contextualisés à la population QPV ciblée par Prescri’Pass.
Assiduité. Les bénéfices reposent sur l’observance. Un abandon avant la 10e à 12e semaine dilue l’effet, d’où l’intérêt d’un suivi à M 3 puis à 6–12 mois.
Évaluation. Privilégier des indicateurs simples et comparables : assiduité, tests de marche et d’équilibre, scores de douleur et de qualité de vie, HbA1c en DT2, événements chutes.
Références
[1] ARS Île-de-France, « Prescri’Pass : l’ARS Île-de-France finance 96 000 séances d’activité physique adaptée… », communiqué, 8 octobre 2025. lien
[2] Ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités, « Activité physique, sédentarité et santé », page de référence, 12 septembre 2025. lien
[3] Inserm, « Activité physique. Prévention et traitement des maladies chroniques – Synthèse et recommandations », expertise collective, janvier 2019. lien
[4] Boniol M. et al., « Physical activity and change in fasting glucose and HbA1c: a quantitative meta-analysis of randomized trials », Acta Diabetologica, 2017. lien
[5] Caducee.net, « Diabète de type 2 : prévenir plus tôt, accompagner mieux », 8 juillet 2025. lien
[6] Caducee.net, « Des parcours de formation en ligne pour prescrire des activités physiques adaptées », 10 octobre 2022. lien
Descripteur MESH : Physique , Santé , France , Personnes , Politique , Risque , Maladie , Essais , Patients , Population , Vie , Travail , Expertise , Qualité de vie , Programmes , Souplesse , Mortalité , Membres , Thérapeutique , Glycémie , Glucose , Diabète de type 2 , Diabète , Maladie coronarienne , Lombalgie , Douleur , Polyarthrite rhumatoïde , Spondylarthrite , Tumeurs du côlon , Côlon , Joue