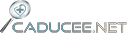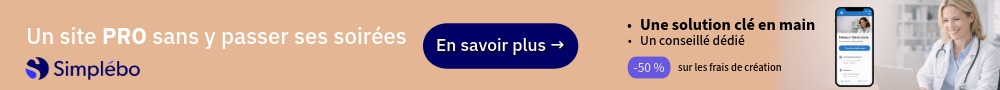Les députés votent la loi Garot, les médecins s’insurgent

Une loi votée dans un hémicycle clairsemé
Mercredi 7 mai, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture la proposition de loi portée par le député socialiste Guillaume Garot et soutenue par un groupe transpartisan d’environ 250 élus. Ce texte vise à réguler l’installation des médecins libéraux et à rétablir l’obligation de permanence des soins (PDS). Malgré l’opposition du gouvernement, la loi a été adoptée par 99 voix contre 9. Le nombre réduit de votants (118 députés présents) a renforcé le sentiment d’injustice ressenti par la profession.
Le texte prévoit que l’installation d’un médecin dans une zone déjà bien pourvue soit conditionnée au départ d’un confrère, sur autorisation de l’Agence régionale de santé. Il inclut également des mesures jugées coercitives, telles que la suppression de la majoration de tarifs pour les patients sans médecin traitant et le retour des gardes obligatoires, abandonnées depuis plus de vingt ans.
Dans une déclaration reprise par Le Monde, Guillaume Garot a salué ce vote en affirmant que « lorsque les déserts médicaux avancent, c'est la République qui recule » et que « nous avons remis un peu de République dans notre organisation collective ».
Sur ce sujet : Les jeunes médecins sont ils redevables envers l’État pour leur formation ?
Une suite législative incertaine, un front syndical déterminé
La proposition doit désormais être examinée par le Sénat, probablement à l’automne. Une autre initiative sénatoriale, portée par la droite et soutenue par le gouvernement, propose une régulation moins contraignante : les médecins pourraient s’installer en zone dense à condition d’exercer à temps partiel dans un territoire sous-doté. Ce projet, aligné sur le plan anti-déserts du gouvernement, pourrait bénéficier d’une procédure accélérée, laissant entrevoir une confrontation législative entre deux approches divergentes.
Face à cela, les syndicats médicaux, les internes et étudiants restent mobilisés. De nombreuses manifestations ont déjà eu lieu, et le mouvement de contestation pourrait s’amplifier. Le Dr Jérôme Marty, président de l’UFMLS (Union française pour une médecine libre), incarne cette fronde syndicale.
Sur ce sujet : PPL Garot : les médecins au bord de la rupture
L’analyse du Dr Marty : un texte vécu comme une trahison
Sur les réseaux sociaux, Jérôme Marty a exprimé avec virulence sa colère et celle de ses confrères. Il qualifie le vote de cette loi de « méprisante » et « insultante » pour la profession, accusant une classe politique déconnectée et hypocrite. Selon lui, cette régulation ne fera qu'aggraver les inégalités d’accès aux soins, en dissuadant les jeunes médecins de s’installer ou en poussant les plus expérimentés à se désengager.
Il dénonce aussi une tentative de faire peser la responsabilité des déserts médicaux sur les épaules des médecins libéraux, alors que ceux-ci exercent déjà dans des conditions difficiles, avec plus de 50 heures de travail hebdomadaire en moyenne. Pour Marty, l’enjeu est aussi démocratique : il s’engage à combattre la loi sur le plan juridique, syndical, et électoral, avec notamment la relance de l’opération de déconventionnement, visant à redonner aux praticiens leur liberté de choix.
Sur X, il affirme : « La médecine libérale a été poignardée dans le dos à l’Assemblée nationale ce 7 mai. » Et d’ajouter : « Rien n’est fini, tout commence. »
L'obligation de garde : retour en arrière ou nécessité ?
Le rétablissement de l’obligation de permanence des soins ambulatoires (PDSA) constitue l’un des volets les plus contestés de la proposition de loi Garot. Supprimée au début des années 2000 après un important mouvement de grève, cette obligation avait été remplacée par un système basé sur le volontariat. Son retour marque une rupture perçue comme brutale par une grande partie de la profession.
Selon les partisans du texte, l’objectif est de garantir une continuité de soins sur tout le territoire, y compris la nuit et les week-ends. Mais les professionnels de santé, eux, y voient un facteur de surcharge insoutenable. Avec en moyenne 55 heures de travail hebdomadaire, des gardes peu rémunérées et sans repos compensateur, les praticiens, dont un tiers a plus de 60 ans, alertent sur une désorganisation structurelle plutôt qu’un manque d’engagement. Les données de l’IGAS montrent que 97 % des besoins de garde sont déjà couverts. Ce n’est donc pas l’absence de médecins qui menace la permanence des soins, mais l’usure du système et l’absence de soutien. Pour éviter un décrochage durable, les syndicats réclament des réformes structurelles et des incitations, plutôt que des obligations unilatérales.
Sur les réseaux, certains médecins alertent sur les effets pervers d’un retour aux gardes obligatoires. Faute de créneaux disponibles en journée, ils craignent un recours abusif aux gardes par les patients, entraînant une saturation des consultations de nuit. Cela rendrait impossible toute activité le lendemain, notamment pour les médecins seuls en poste. L’un d’eux redoute un désengagement massif, notamment des retraités, et évoque la possibilité d’une mobilisation collective inspirée de la grève de 2002.
Face à cette pression, une stratégie de résistance passive est évoquée : n’accepter les consultations que si elles sont passées par la régulation du 15, excluant tout accueil direct non filtré. Une manière de souligner les limites opérationnelles du dispositif sans en violer explicitement les règles. Pour certains, « la contrainte ne peut remplacer l’incitation quand il s’agit de rétablir la confiance ».
Cette mesure, en voulant régler un problème réel, pourrait en créer de nouveaux, plus graves encore. Elle cristallise à elle seule le malaise profond d’une profession qui estime ne plus être écoutée.
Sur ce sujet : Fin de la liberté d’installation ? L’Assemblée vote une régulation inédite
Médecins et patients tous perdants ?
L’impact potentiel de cette loi inquiète bien au-delà du corps médical. Si l’objectif affiché est de corriger les déséquilibres territoriaux, la méthode pourrait produire l’effet inverse. En restreignant la liberté d’installation, la loi risque de décourager les vocations, d’accroître les tensions dans les zones déjà tendues, et de nourrir un sentiment de contrainte parmi les praticiens.
Les patients pourraient à terme être les premières victimes d’une telle mesure, avec un accès aux soins encore plus compromis dans certaines régions, faute de candidats prêts à accepter des conditions d’installation rigides. L’expérience passée montre que les politiques coercitives n’ont jamais réellement fonctionné dans le domaine de la démographie médicale. L'incitation, l'accompagnement des jeunes médecins, et la modernisation des conditions d’exercice semblent des leviers bien plus prometteurs.
Le ministre de la Santé Yannick Neuder, cité par Le Monde, a reconnu : « Même si nous ne sommes pas d’accord sur la solution, nous partageons le constat que les déserts médicaux restent la principale préoccupation des citoyens. » Il a ajouté dans l'hémicycle : « Si j'avais pensé que c'était le bon traitement, le bon remède à la situation, je l'aurais soutenu. »
Agnès Giannotti, présidente de MG France, a résumé la position majoritaire des généralistes : « Le “bon sens” et le fait de “n’avoir jamais essayé cette mesure” ne suffisent pas à mener un pilotage sérieux de l’offre de soins. »
Du côté des spécialistes, Patrick Gasser (Avenir Spé) avertit que « ce texte vaut sanction générationnelle, parce que ce sont les jeunes médecins qui, demain, seront pénalisés » et que « l’absence de cohérence ne peut qu’engendrer une perte de confiance dans l’action politique ».
Une médecine libérale fragilisée par un projet populiste
Le débat sur les déserts médicaux ne saurait éluder les vraies causes du problème : attractivité des territoires, organisation des soins, reconnaissance du travail médical. Plutôt que de stigmatiser une profession déjà en tension, le législateur gagnerait à écouter les premiers concernés. Les médecins n’ont pas déserté les territoires : ce sont souvent les moyens, le temps et la reconnaissance qui leur font défaut.
En persistant dans une logique punitive et unilatérale, la classe politique démontre une méconnaissance inquiétante du quotidien médical. Le vote de cette loi dans un hémicycle presque vide illustre une forme de désinvolture institutionnelle, où l'affichage politique prend le pas sur la réalité des soins. Cette posture traduit moins une volonté de réforme qu’un réflexe populiste : donner l’illusion d’agir vite et fort face à une opinion inquiète, quitte à sacrifier la cohérence et la concertation.
Plutôt que de s’attaquer aux racines structurelles de la désertification médicale, les parlementaires ont préféré désigner un coupable commode : le médecin libéral, devenu cible politique facile. Le message est clair : on gouverne pour l’électeur frustré, pas avec les soignants.
Imposer, contraindre, réguler à outrance sans dialogue ni co-construction ne fera qu’aggraver une crise déjà installée. Le risque est double : démobiliser les praticiens et désespérer les patients. Une médecine libérale fragilisée, c’est tout le système de santé qui vacille. Il est encore temps de changer de méthode, en partant d’un principe simple : écouter ceux qui soignent.
Descripteur MESH : Médecins , Santé , Liberté , Lecture , Soins , Politique , Patients , Médecine , Temps , Gouvernement , Mouvement , Travail , Risque , Permanence des soins , France , Logique , Repos , Corps médical , Étudiants , Syndicats , Face , Démographie , Posture , Voix , Virulence , Vide , Confiance , Colère , Soins ambulatoires , Réflexe , Rupture , Dos , Front