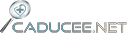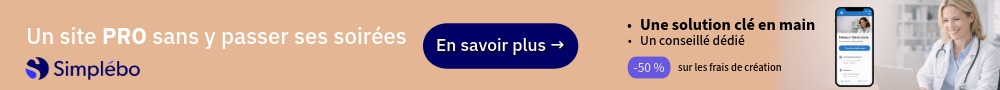Le médecin traitant : boussole ou obstacle ?

Quand l’Académie bouscule le parcours de soins
En juin 2025, l’Académie nationale de médecine a publié un rapport intitulé Les pénuries en médecins spécialistes, hors médecine générale (adopté le 24 juin 2025, 64 voix pour, 4 contre, 7 abstentions), qui a suscité une vive controverse en qualifiant le parcours du médecin traitant de « handicap » dans l’organisation du système de santé français. Cette proposition, visant à fluidifier l’accès aux spécialistes pour répondre aux pénuries médicales, a provoqué l’indignation des médecins généralistes, qui défendent leur rôle central dans la coordination des soins.
Le point de vue de l’Académie nationale de médecine
Le rapport (RAPPORT-PENURIES-DE-MEDECIN-APRES-VOTE.pdf) met en lumière les pénuries de médecins spécialistes (hors médecine générale), un problème vécu « très négativement » par les Français, avec des disparités territoriales et spécialisées marquées. Selon le Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM), en 2025, sur 201 239 médecins actifs, 40,7 % sont généralistes, 46,5 % spécialistes médicaux, et 12,7 % chirurgiens. Si le nombre de spécialistes a augmenté ( 24,4 % pour les médicaux, 23,1 % pour les chirurgicaux entre 2015 et 2025), cette croissance profite surtout aux hospitaliers ( 18,8 %) et aux exercices mixtes ( 17,4 %), tandis que les spécialistes libéraux diminuent (-4,7 %). En comparaison, les généralistes ont vu leurs effectifs baisser de 1,4 % sur la même période.
L’Académie identifie quatre causes principales des pénuries :
-
Un nombre insuffisant de spécialistes formés, face aux besoins croissants d’une population vieillissante et à l’augmentation des pathologies chroniques et cancers.
-
Une organisation des soins basée sur l’offre, plutôt qu’une approche populationnelle, jugée « surannée ».
-
Une répartition territoriale déséquilibrée, avec des inégalités aggravées par la démographie (ex. 45 000 habitants par an en Occitanie) et la concentration des Centres Hospitaliers Universitaires (CHU).
-
Un manque d’attractivité, particulièrement pour l’exercice libéral, avec des délais de consultation pouvant atteindre plusieurs mois pour des spécialités comme la dermatologie ou la rhumatologie.
Pour remédier à ces défis, l’Académie propose une série de recommandations, dont une réorganisation des soins pour dépasser le modèle actuel, centré sur le médecin généraliste comme « porte d’entrée obligatoire » (p. 6). Le rapport critique l’idée que le médecin traitant soit systématiquement le premier recours, notant que pour certaines pathologies, un spécialiste peut devenir de facto le médecin traitant. Il suggère un accès direct à certaines spécialités (dermatologie, rhumatologie, urologie, orthopédie) pour réduire les délais et rationaliser certaines prescriptions (ex. IRM du genou), tout en maintenant le rôle de coordination du généraliste. Cette proposition s’inscrit dans une vision de « décloisonnement » du système, intégrant les nouvelles technologies comme l’intelligence artificielle (IA) et la télémédecine, et une approche territorialisée impliquant les Agences Régionales de Santé (ARS) et les collectivités locales (p. 2).
L’Académie insiste également sur :
-
Une planification prospective des besoins : Développer un « index territorial de santé » basé sur des données épidémiologiques et des indicateurs comme l’Accessibilité Potentielle Localisée (APL) pour mieux quantifier les besoins par territoire et spécialité (p. 8-9).
-
Une universitarisation territoriale : Encourager la fidélisation des étudiants en médecine dans leurs régions via des stages en zones sous-dotées, des antennes universitaires, et des postes d’enseignants associés financés par les régions et les ARS (p. 10).
-
Une attractivité renforcée : Améliorer les conditions de travail, la rémunération, et l’accès à des plateaux techniques modernes pour encourager l’installation, notamment en libéral (p. 7).
-
Une organisation en réseaux : S’inspirer de spécialités comme l’urologie, qui a structuré des équipes de 3 à 5 praticiens couvrant des surspécialités, réduisant l’isolement et améliorant la continuité des soins (p. 34-35).
L’Académie argue que le système actuel, centré sur l’offre, ne répond plus aux besoins d’une population diversifiée et vieillissante, et que le parcours du médecin traitant, bien qu’essentiel, peut être un frein dans certains cas, notamment pour l’accès rapide à des spécialistes en zones sous-dotées.
La réponse des généralistes : un pilier essentiel
Le 7 juillet 2025, un communiqué conjoint de syndicats (MG France, FMF, Médecins pour Demain, Isnar-IMG, SML, CSMF, UFML-Syndicat, SOS Médecins France) a dénoncé la proposition de l’Académie comme une « remise en cause brutale et injustifiée ». Les généralistes soutiennent que :
-
Le médecin traitant est un repère : Il assure la coordination, connaît les patients, et garantit la cohérence des soins, réduisant les risques de fragmentation.
-
Un modèle validé : Des études internationales (ex. OCDE) montrent que les systèmes avec un médecin traitant fort améliorent la qualité, l’efficacité et l’efficience des soins.
-
Les vrais problèmes : Les difficultés d’accès aux soins découlent d’un manque de moyens, de reconnaissance, et d’attractivité pour la médecine générale, et non d’un excès de coordination.
Ils qualifient l’idée de « handicap » comme une « confusion entre la boussole et l’ornière », plaidant pour un renforcement de la médecine générale plutôt qu’un contournement.
Échos dans la communauté médicale
Sur X, plusieurs professionnels de santé ont exprimé leur frustration. L’un d’eux redoute que la réforme pousse certains généralistes vers des activités moins exigeantes, tandis qu’un autre regrette l’absence d’évaluation du dispositif du médecin traitant, en vigueur depuis deux décennies, et son incapacité à infléchir le déficit de la Sécurité sociale. Ces réactions reflètent un sentiment d’abandon face à des conditions de travail dégradées.
Construire une réponse concertée
Le rapport de l’Académie nationale de médecine met en avant une vision pragmatique pour répondre aux pénuries de spécialistes, mais sa proposition de dépasser le parcours du médecin traitant a été mal reçue par les généralistes, qui y voient une menace pour la coordination des soins. Plutôt que d’opposer les deux approches, une solution équilibrée consisterait à renforcer la médecine générale tout en facilitant l’accès aux spécialistes dans des contextes ciblés, en s’appuyant sur des réseaux territoriaux et des technologies modernes. Les pistes évoquées de part et d’autre mériteraient d’être articulées dans une approche concertée. En 2025, face à un système de santé sous tension, le médecin traitant reste un pilier, mais il doit être soutenu par des moyens accrus et une collaboration renforcée avec les spécialistes.
Ressources
-
Académie nationale de médecine : Rapport 2025
-
Communiqué des syndicats : FMF
Descripteur MESH : Soins , Médecine , Médecins , Santé , Médecine générale , Face , Travail , France , Syndicats , Population , Rhumatologie , Dermatologie , Rôle , Croissance , Index , Sécurité , Continuité des soins , Voix , Sécurité sociale , Centres hospitaliers universitaires , Rémunération , Conseil , Genou , Patients , Médecins généralistes , Confusion , Lumière , Étudiants , Démographie , Frustration , Télémédecine , Urologie , Orthopédie