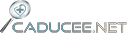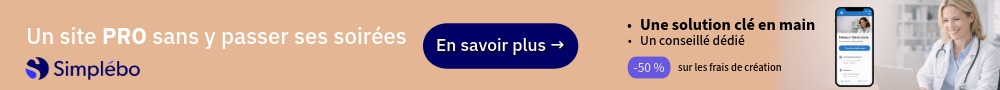Conflit en Europe : le système de santé français se prépare, révèle Le Canard Enchaîné
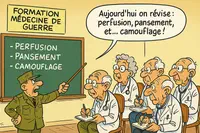
Des consignes pour gérer un afflux massif et prolongé de victimes
Le 18 juillet, Catherine Vautrin aurait transmis une instruction aux directeurs des agences régionales de santé (ARS). Ces derniers devraient d’ici mars 2026 être prêts à gérer un « engagement majeur », autrement dit un conflit armé de grande ampleur.
Le plan prévoit la création de centres médicaux proches des gares, ports ou aéroports pour accueillir quotidiennement jusqu’à 100 soldats étrangers blessés, avec une capacité portée à 250 lors de pics. Les hôpitaux civils seraient mobilisés pour prendre en charge entre 100 000 et 500 000 combattants en transit sur une période allant de quelques semaines à plusieurs mois.
Le personnel de santé réquisitionné
Tous les professionnels, quel que soit leur secteur d’activité, pourraient être sollicités pour renforcer le Service de santé des armées (SSA), qui compte actuellement 14 000 personnes. Les autorités demandent déjà aux ARS de sensibiliser les soignants à travailler dans un contexte de pénurie de ressources et d’afflux massif de patients.
Un volet particulier concerne le suivi psychologique et la réadaptation des blessés, mais aussi la vaccination et le dépistage des troupes alliées. Selon l’instruction, la France doit être prête à assumer son rôle de base arrière de l’OTAN en cas d’attaque d’un État membre.
Un cadre existant pour les crises sanitaires
La préparation du système hospitalier français à une situation d’urgence n’est pas nouvelle. Depuis plusieurs années, les établissements de santé s’appuient sur les plans blancs, dispositifs conçus pour gérer des afflux massifs de victimes, qu’il s’agisse d’attentats, de catastrophes naturelles ou de pandémies. Ce cadre a d’ailleurs été renforcé après la crise du Covid-19, avec des guides méthodologiques actualisés pour permettre une montée en charge progressive des capacités hospitalières.
En complément, le dispositif dit « établissement en tension » offre une flexibilité supplémentaire, permettant aux hôpitaux d’adapter leurs ressources sans déclencher immédiatement l’ensemble des mesures d’urgence. Cette architecture organisationnelle pourrait aujourd’hui être mobilisée dans un contexte de guerre de haute intensité.
Un partenariat déjà structuré entre santé civile et militaire
La question de la coopération entre civils et militaires est au cœur de la réflexion. Dans un rapport de 2023, la Cour des comptes rappelait que le Service de santé des armées (SSA) ne pourrait absorber seul un afflux massif de blessés, en raison d’années de restrictions budgétaires et de la fermeture de structures emblématiques comme le Val-de-Grâce.
Le SSA, qui s’appuie sur ses hôpitaux de référence (Percy, Bégin, Sainte-Anne, Laveran), a déjà renforcé son rôle dans la gestion des crises sanitaires. Il coopère régulièrement avec les hôpitaux civils, notamment pour les missions de veille épidémiologique et de santé publique confiées au Centre d’épidémiologie et de santé publique des armées (CESPA). Cette collaboration devrait se resserrer encore davantage en cas de conflit armé, avec une logique de mutualisation des moyens et des expertises.
Une stratégie nationale et européenne de préparation
Ces directives s’inscrivent dans la Revue nationale stratégique 2025, qui dresse un constat préoccupant de la sécurité mondiale et appelle la France à se préparer à une guerre de haute intensité aux portes de l’Europe. Le budget de défense, porté à 413 milliards d’euros pour 2024-2030, illustre cette montée en puissance.
La France n’est pas isolée dans cette démarche : en Europe de l’Est, la Lituanie, l’Estonie, la Lettonie ou la Pologne investissent déjà massivement dans la préparation médicale, multipliant les exercices d’évacuation et développant des infrastructures hospitalières souterraines pour anticiper un afflux massif de blessés en cas d’attaque russe. En 2025, la Lituanie a ainsi programmé plusieurs exercices de médecine de guerre impliquant civils et militaires, tandis qu’en Estonie des simulations d’évacuation ont été menées pour tester la rapidité de la chaîne de soins en cas d’attaque. Ces exemples concrets montrent que la préparation sanitaire s’inscrit désormais dans une dynamique européenne de défense collective.
Entre discours pacifistes et réalités stratégiques
Cette planification intervient alors qu’Emmanuel Macron réaffirme publiquement son attachement à une solution politique en Ukraine. Mais en coulisses, Paris met en place les conditions d’une réponse sanitaire et militaire conforme à ses obligations au titre du traité de Washington qui fonde l’OTAN.
Le contraste entre le discours officiel et les préparatifs opérationnels n’a pas échappé aux observateurs : il témoigne d’une double posture, diplomatique et défensive, qui vise à préserver la paix tout en anticipant le pire.
Source : Le ministère de la Santé mobilise les hôpitaux pour la guerre, Le canard enchainé du 26/08/2025
Descripteur MESH : Santé , Europe , Guerre , Hôpitaux , Ukraine , Gouvernement , France , Lituanie , Santé publique , Discours , Rôle , Pologne , Lettonie , Estonie , Patients , Paris , Directives , Pandémies , Sécurité , Catastrophes , Établissements de santé , Démarche , Personnel de santé , Personnes , Logique , Aéroports , Coopération , Politique , Soins , Médecine , Posture , Mars , Vaccination