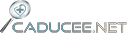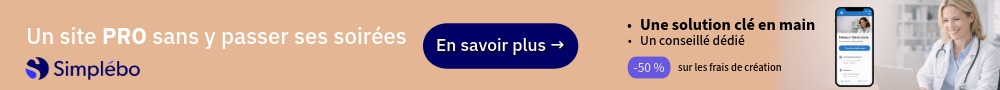La psilocybine dans le traitement des troubles liés à l’alcool et à la dépression : premiers résultats prometteurs d’une étude pilote française

Contexte et objectifs de l’étude
Le trouble de l’usage de l’alcool (TUA) associé à une dépression comorbide représente un défi majeur en santé publique, caractérisé par un risque élevé de rechute et une réponse limitée aux traitements conventionnels. Une étude pilote française, menée au CHU de Nîmes et publiée le 1er juillet 2025 dans la revue Addiction, explore le potentiel de la psychothérapie assistée par la psilocybine, une substance psychédélique, dans cette population. Cet article examine les résultats, les implications cliniques et les perspectives pour les professionnels de santé.
L’étude PAD (Psilocybin in Alcohol Dependence), dirigée par le Pr Amandine Luquiens, addictologue au CHU de Nîmes, est la première en France à évaluer la faisabilité, l’acceptabilité et l’efficacité préliminaire de la psilocybine chez des patients récemment sevrés (2 à 8 semaines) souffrant de TUA sévère (DSM-5) et de dépression (score BDI-II ≥ 14). Cette approche s’inscrit dans un regain d’intérêt international pour les thérapies psychédéliques, stimulé par les limites des traitements actuels, où environ 50 % des patients alcoolodépendants rechutent dans les six mois post-sevrage et un tiers des dépressifs résistent aux antidépresseurs classiques.
Méthodologie
L’étude, prospective, monocentrique, randomisée, en double aveugle (2:1), a inclus 30 patients adultes (âge moyen : 49 ± 10 ans, 43 % de femmes). Les participants ont reçu deux administrations orales de psilocybine à 25 mg (n=20) ou 1 mg (placebo actif, n=10), espacées de trois semaines, en complément d’un programme intensif de prévention de la rechute. Les critères principaux étaient la faisabilité (participation aux deux sessions, taux de recrutement) et l’acceptabilité. Les critères secondaires incluaient l’abstinence (Alcohol Timeline Followback), le temps jusqu’à la rechute, le craving (Craving Experience Questionnaire), les symptômes dépressifs (BDI-II), la sécurité et l’intégrité de l’aveugle.
Le protocole comprenait une préparation psychothérapeutique, une administration dans un environnement sécurisé (chambre transformée en espace apaisant avec musique adaptée) et une séance d’intégration post-administration pour maximiser les bénéfices introspectifs et réduire les effets secondaires.
Résultats
À 12 semaines, le groupe à 25 mg a montré une abstinence significativement plus élevée (55 % vs 11 %, différence = -44 %, IC 95 % : -82 % à -5,9 %, p = 0,043), une réduction des jours de consommation (-100 vs -93, p = 0,038) et du craving (-8 vs 7, p = 0,045) par rapport au groupe placebo. Les symptômes dépressifs ont diminué dans les deux groupes, sans différence significative liée aux antidépresseurs. Vingt-cinq événements indésirables mineurs (maux de tête, nausées, fatigue) ont été rapportés chez 50 % des patients du groupe 25 mg, contre 60 % dans le groupe placebo. L’aveugle était imparfait (93,3 % des patients et 86,7 % des investigateurs ont deviné le groupe), un biais fréquent dans les études sur les psychédéliques.
« Ces résultats, bien que préliminaires, montrent qu’un traitement assisté par la psilocybine peut s’intégrer dans un cadre hospitalier sécurisé et encadré, et méritent d’être explorés dans des essais de plus grande ampleur », déclare le Pr Amandine Luquiens, médecin addictologue au CHU de Nîmes et investigatrice principale de l’étude.
Implications pour la pratique clinique
-
Efficacité préliminaire : Les taux d’abstinence et la réduction du craving suggèrent un potentiel thérapeutique de la psilocybine, particulièrement pour les patients avec TUA et dépression comorbide, où les traitements standards sont souvent insuffisants. L’effet rapide et durable (jusqu’à 12 semaines après deux doses) contraste avec les antidépresseurs classiques, qui nécessitent plusieurs semaines pour agir.
-
Faisabilité et sécurité : L’étude démontre que la psychothérapie assistée par la psilocybine est réalisable dans un cadre hospitalier français, avec un encadrement psychothérapeutique rigoureux réduisant les risques. Aucun effet secondaire grave n’a été rapporté, et le protocole a été bien toléré, malgré des effets mineurs comme des maux de tête ou des expériences émotionnelles intenses.
-
Défis éthiques et logistiques : L’administration de psilocybine est chronophage, nécessitant plusieurs heures d’accompagnement par des soignants formés, ce qui peut poser des problèmes dans le contexte actuel de tension des ressources hospitalières. Cependant, si son efficacité est confirmée, ce traitement pourrait être efficient, une seule ou deux doses pouvant induire une rémission prolongée.
Perspectives et limites
Cette étude pilote ouvre la voie à des essais à plus grande échelle, comme les projets PAPAUD (psilocybine) et ADELY (LSD), en attente d’autorisation en France. Cependant, plusieurs limites doivent être considérées :
-
Taille de l’échantillon : Avec seulement 30 participants, les résultats restent préliminaires et nécessitent des études plus vastes pour confirmer l’efficacité et évaluer le rapport bénéfice/risque.
-
Statut légal : La psilocybine reste classée comme stupéfiant en France, limitant son accès à des essais cliniques autorisés par l’ANSM. Cette restriction freine la recherche par rapport à des pays comme la Suisse ou les États-Unis.
-
Biais de l’aveugle : La reconnaissance fréquente du groupe de traitement par les patients et les investigateurs peut influencer les résultats, un défi méthodologique récurrent dans les études sur les psychédéliques.
-
Contre-indications : Les patients présentant des troubles psychiatriques comme la schizophrénie ou des antécédents cardiaques doivent être exclus en raison des risques d’effets secondaires graves.
Recommandations pour les professionnels de santé
-
Formation spécifique : Les soignants impliqués dans les thérapies psychédéliques doivent être formés à l’accompagnement des états altérés de conscience, à la gestion des effets secondaires (anxiété, reviviscences) et à la psychothérapie intégrative.
-
Suivi interdisciplinaire : Une collaboration entre psychiatres, addictologues, psychologues et neuroscientifiques est essentielle pour optimiser les protocoles et comprendre les mécanismes d’action, notamment via l’imagerie cérébrale et les biomarqueurs.
-
Sensibilisation : Les professionnels doivent être informés du potentiel thérapeutique des psychédéliques, tout en restant critiques face aux limites actuelles des données et aux contraintes réglementaires.
Conclusion
L’étude PAD du CHU de Nîmes marque une étape pionnière dans la recherche française sur les thérapies psychédéliques. Les résultats prometteurs sur l’abstinence et le craving chez les patients avec TUA et dépression soulignent le potentiel de la psilocybine comme complément à la psychothérapie. Toutefois, des études à plus grande échelle et une évolution du cadre légal sont nécessaires pour intégrer cette approche dans la pratique clinique. Les professionnels de santé sont invités à suivre ces avancées, qui pourraient redéfinir la prise en charge des pathologies mentales complexes.
Références
-
Luquiens, A., et al. (2025). Psilocybin in alcohol use disorder and comorbid depressive symptoms: Results from a feasibility randomized clinical trial. Addiction.
-
Inserm. (2024). Substances psychédéliques : une révolution pour traiter la dépression ?
-
Sciences et Avenir. (2024). Médecine psychédélique et maladies mentales : une étude inédite menée en France.
-
Le Figaro. (2024). Champignons hallucinogènes : une première expérimentation menée en France avec la psilocybine.
Descripteur MESH : Psilocybine , Dépression , Patients , Psychothérapie , France , Placebo , Essais , Antidépresseurs , Santé , Recherche , Mineurs , Thérapeutique , Tête , Population , Femmes , Sécurité , Musique , Santé publique , Suisse , Environnement , Sevrage , Temps , Schizophrénie , Conscience , Objectifs , Anxiété , Addiction , Risque , Hallucinogènes , Fatigue , Face