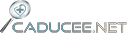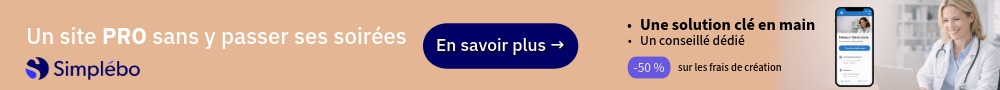Cigarette électronique : dans quels cas le médecin peut-il la proposer en sevrage tabagique ?

Résumé
La cigarette électronique n’est pas recommandée comme traitement de première intention par la HAS (2023) et le HCSP (2022), qui privilégient les substituts nicotiniques (TSN) et la varénicline. Toutefois, dans des cas spécifiques (échec des TSN, forte dépendance, comorbidités nécessitant un arrêt urgent), la vape peut être envisagée sous encadrement médical strict, avec un objectif d’arrêt total en 6-12 mois. Les médecins doivent informer sur les risques (respiratoires, cardiovasculaires, dépendance) et éviter son usage chez les femmes enceintes, mineurs et non-fumeurs.
Conduite à tenir pour les médecins
Évaluation : Test de Fagerström, motivation, comorbidités.
Information : Souligner la moindre nocivité (10-450 fois moins de toxines vs tabac), mais risques persistants (respiratoires, cardiovasculaires, dépendance).
Stratégie :
- Première intention : TSN, varénicline, TCC.
- Option secondaire : Cigarette électronique en cas d’échec/intolérance aux TSN, forte dépendance, ou comorbidités graves (ex. : BPCO, post-infarctus).
- Contre-indications : Femmes enceintes, mineurs, non-fumeurs.
Suivi :
- Dispositif rechargeable, e-liquide conforme (1 mg nicotine/cigarette fumée).
- Suivi mensuel : CO expiré, spirométrie (si BPCO), ECG (si risque cardiovasculaire).
- Objectif : arrêt total (tabac + vape) en 6-12 mois.
- Déclarer les effets indésirables via Signalement-Santé.
Pluridisciplinarité : Orienter vers tabacologues, psychologues (TCC), pharmaciens.
Contexte épidémiologique et réglementaire
Épidémiologie du tabac et de la vapote en France (2023)
En 2023, le tabagisme reste une préoccupation majeure de santé publique en France, avec 31,1 % des adultes âgés de 18 à 75 ans déclarant fumer, dont 23,1 % de manière quotidienne, selon Santé publique France. Ce niveau, le plus bas jamais enregistré, reflète une baisse progressive depuis 2016, bien que le tabagisme occasionnel ait légèrement augmenté pour atteindre 8,0 %. Les inégalités sociales sont marquées : la prévalence est plus élevée chez les personnes à faible revenu (28,9 %) et les chômeurs (35,7 %), contre 17,3 % pour les revenus les plus élevés. Le tabac cause plus de 75 000 décès par an, principalement liés aux cancers, aux maladies cardiovasculaires et respiratoires, soulignant l’urgence de politiques de prévention renforcées.
Le vapotage, en pleine expansion, concerne 8,3 % des 18-75 ans, dont 6,1 % vapotent quotidiennement, une hausse notable par rapport à 5,5 % en 2022. Utilisée majoritairement comme outil de réduction ou d’arrêt du tabagisme, la vapote attire 60 % des vapoteurs dans ce but, bien que son efficacité à long terme reste débattue. Les hommes (6,8 %) vapotent légèrement plus que les femmes (5,4 %), et la pratique est particulièrement répandue chez les anciens fumeurs. Cependant, des incertitudes persistent sur les effets à long terme, notamment pour les non-fumeurs, ce qui appelle à une surveillance accrue des autorités sanitaires.
Ces tendances mettent en lumière des dynamiques contrastées : le tabagisme diminue lentement mais reste ancré dans les populations défavorisées, tandis que la vapote gagne du terrain comme alternative, avec des bénéfices et des risques encore mal définis. Les politiques publiques, comme le Programme national de lutte contre le tabac 2023-2027, visent à réduire la prévalence du tabagisme tout en encadrant le vapotage, afin de minimiser les risques pour la santé publique tout en tenant compte des inégalités sociales et des nouveaux comportements.
Statut réglementaire actuel en France
- La cigarette électronique n’a pas le statut de médicament ni de dispositif médical ; elle reste classée « produit du tabac » par l’Union européenne et par la réglementation française.
- Aucune prise en charge par l’Assurance Maladie n’est prévue, contrairement aux substituts nicotiniques (remboursés à 65 %).
- Taux de nicotine limité à 20 mg/ml, obligation d’étiquetage de sécurité.
- Le Code de la santé publique interdit la vente aux mineurs, l’usage dans les espaces collectifs fermés et, depuis le 26 février 2025, la commercialisation des dispositifs jetables (« puffs ») – voir l’actualité officielle Interdiction des « puffs »
Des recommandations officielles prudentes mais contestées
Recommandations actualisées de la HAS (2023)
Dans sa révision des recommandations concernant l’arrêt du tabac en premiers recours, la HAS réaffirme l’intérêt d’un sevrage accompagné par un professionnel de santé et appuyé par un traitement validé. Les substituts nicotiniques s’imposent toujours comme le traitement de première intention, y compris chez la femme enceinte à partir de 15 ans, en raison de leur innocuité relative et de leur efficacité démontrée. Faute de données scientifiques suffisantes, les dispositifs de vapotage, y compris les nouvelles cigarettes électroniques, sont exclus des recommandations officielles de la HAS pour le sevrage tabagique.
Néanmoins, la HAS reconnaît implicitement le rôle que peut jouer la cigarette électronique dans une démarche individuelle de réduction des risques chez certains patients réfractaires aux méthodes conventionnelles ou présentant une forte dépendance au tabac. Dans ce cas, un accompagnement structuré est recommandé. L’usage de la vape doit être limité dans le temps, viser l’arrêt total du tabac, et ne jamais concerner les mineurs ni les femmes enceintes. La fabrication de liquides maison ou l’achat de produits non conformes est également proscrite. La HAS déconseille le vapofumage qui consiste à associer le tabac et vapotage, en raison de l’absence de bénéfices pour le patient.
Les recommandations de la HAS soulignent enfin le besoin d’études complémentaires pour mieux évaluer l’efficacité et la sécurité à long terme de ces dispositifs, et renforcent l’appel à la vigilance face à l’essor du vapotage chez les jeunes publics.
Les recommandations du HCSP de 2022 ne font pas l’unanimité
Le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) a publié un avis en janvier 2022 sur l’usage de la cigarette électronique dans le sevrage tabagique. Il estime que les données scientifiques disponibles sont insuffisantes pour recommander la vape comme outil thérapeutique aux professionnels de santé. Le HCSP reconnaît toutefois qu’elle pourrait représenter une aide individuelle hors du cadre médical, avec une tolérance jugée satisfaisante à court terme.
Cette position, jugée incohérente par certains spécialistes, interdit aux médecins de conseiller une méthode pourtant décrite comme potentiellement utile pour l’arrêt du tabac. Pour l’association Santé Respiratoire, le Pr Bertrand Dautzenberg dénonce une position « schizophrène » : pourquoi refuser à un professionnel ce que l’on tolère en automédication ? Selon lui, la vape s’intègre efficacement dans une stratégie de sevrage encadrée, en association avec d’autres substituts nicotiniques.
« Alors que le Haut conseil décrit la vape comme un bon moyen de sevrage pour le fumeur souhaitant arrêter le tabac sans l’aide d’un professionnel de santé, il refuse au médecin la possibilité de la conseiller ! Quel médicament est bon lorsqu’il est pris en automédication et déconseillé lorsqu’il est prescrit par un médecin ? »
Pr Bertrand Dautzenberg pour Santé Repiratoire
Une approche populationnelle versus une logique individualisée
Le débat révèle un clivage entre deux approches : celle, réglementaire, fondée sur les preuves et les normes internationales, défendue par le Dr Ivan Berlin, et celle, plus pragmatique et humaniste, portée notamment par le Dr Frédéric Le Guillou. Ce dernier plaide pour une prise en compte du contexte individuel, dans le cadre d’une décision partagée entre médecin et patient, même en l’absence d’AMM pour la vape.
Les experts favorables à son intégration dans l’arsenal thérapeutique soulignent qu’un accompagnement médical permettrait de limiter les usages dévoyés (comme le vapofumage) et d’optimiser les chances de sevrage, tant du tabac que de la nicotine.
Une efficacité probable mais non démontrée sur le long terme
Le HCSP reconnaît une probabilité de moindre nocivité par rapport au tabac et un effet bénéfique sur le sevrage dans certains cas, tout en rappelant l’absence d’études robustes sur les effets indésirables graves ou comparant la vape aux traitements validés. Des institutions comme l’OMS ou la Société francophone de tabacologie appellent à la prudence, recommandant une utilisation transitoire uniquement en cas d’échec des autres traitements.
La question de la double consommation (tabac + vape), jugée contre-productive, fait consensus : elle doit être évitée. Le rôle du professionnel de santé est alors de guider vers un usage exclusif et temporaire de la vape, en fixant un objectif d’arrêt complet.
Les 13 recommandations du HCSP
- Prioriser les traitements ayant une efficacité démontrée (substituts nicotiniques, varénicline, cytisine).
- Niveau de preuve insuffisant pour recommander systématiquement les cigarettes électroniques.
- Un rapport bénéfice/risque favorable possible pour certains patients vulnérables (comorbidités, co-addictions).
- Déconseiller l’utilisation durant la grossesse. Privilégier les substituts validés.
- Utilisation éventuelle chez des patients fortement dépendants et peu réceptifs aux traitements validés.
- Mise en place d’un système de « vapovigilance » accessible sur Signalement-Santé.
- Interdiction stricte de vente aux mineurs.
- Maintien de mesures réglementaires limitant attractivité et accessibilité.
- Élaboration de recommandations spécifiques selon les analyses ANSES.
- Informer les patients sur les incertitudes des effets à long terme.
- Proscrire le double usage tabac/cigarette électronique (« vapofumage »).
- Déconseiller formellement les mélanges artisanaux (« do it yourself »).
- Renforcer l’éducation sanitaire auprès des jeunes sur ces enjeux.
Position actualisée de la SPLF (2025)
Dans une session de juin 2025, la Société de Pneumologie de Langue Française (SPLF) rappelle que l’arrêt du tabac réduit significativement le risque de pathologies cancéreuses et non cancéreuses. Si certaines études montrent que la cigarette électronique avec nicotine est plus efficace que les substituts nicotiniques pour obtenir l’abstinence, d’importantes limites demeurent.
La SPLF insiste sur un fait préoccupant : environ 45 % des vapoteurs deviennent des vapofumeurs, c’est-à-dire conservent un usage simultané de tabac et de cigarette électronique. Cette double consommation n’apporte pas de bénéfice démontré en termes de réduction des risques. À long terme, les taux de rechute sont élevés. Par ailleurs, les risques respiratoires et cardiovasculaires liés à l’utilisation exclusive de la vape commencent à être documentés, en particulier avec les systèmes modernes riches en nicotine.
La SPLF estime qu’il n’existe pas à ce jour de certitude formelle sur l’efficacité de la cigarette électronique comme outil de sevrage à l’échelle populationnelle. Elle alerte sur le risque d'encourager un usage à grande échelle dans la population générale, qui pourrait au contraire entretenir une dépendance nicotinique et favoriser le vapofumage. La prudence reste de mise.
Recommandations internationales sur l’usage de la cigarette électronique dans le sevrage tabagique
Les approches concernant l’utilisation de la cigarette électronique dans le sevrage tabagique varient selon les pays, reflétant des différences dans les cadres réglementaires, les données scientifiques disponibles et les priorités de santé publique.
Le Royaume-Uni promeut activement la cigarette électronique comme outil de réduction des risques, estimée 95 % moins nocive que le tabac (Public Health England, 2021). Les médecins peuvent la recommander aux fumeurs réfractaires aux substituts nicotiniques (TSN), avec un suivi strict et des dispositifs réglementés (NICE, 2021). En Nouvelle-Zélande, la vape est intégrée dans les stratégies de sevrage, notamment pour les populations vulnérables, avec un encadrement médical et des produits conformes (Ministry of Health, 2024). Aux États-Unis, la FDA classe la vape comme produit du tabac, tolérée pour la réduction des risques chez les fumeurs adultes, mais non recommandée officiellement ; les TSN sont prioritaires, et les arômes sont restreints dans certains États (FDA, 2023).
L’Allemagne autorise la cigarette électronique comme produit du tabac, mais le Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ) ne la recommande pas officiellement, privilégiant les TSN et les thérapies validées. Elle est tolérée pour les fumeurs dépendants, sous supervision, avec des restrictions sur les lieux publics et une taxe sur les e-liquides. Le Canada adopte une approche prudente, tolérant la vape pour les fumeurs réfractaires, mais priorisant les TSN et la varénicline (Santé Canada, 2023). L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande la prudence face au manque de preuves sur l’innocuité à long terme, limitant la vape à des contextes encadrés et déconseillant son usage chez les non-fumeurs (WHO, 2024).
Contrairement au Royaume-Uni et à la Nouvelle-Zélande, où la vape est promue, la France, l’Allemagne, le Canada et les États-Unis adoptent une approche plus restrictive, privilégiant les TSN. Ces divergences, reflétant des priorités variées (réduction des risques vs protection des jeunes), nécessitent que les médecins français expliquent la position nationale face aux attentes des patients influencés par des sources internationales.
Revue Cochrane (2025) : des résultats en faveur de la cigarette électronique face aux TNS pour le sevrage tabagique
La revue Cochrane 2025 a établi que les cigarettes électroniques avec nicotine augmentent les chances d'arrêt du tabac par rapport aux substituts nicotiniques, aux cigarettes électroniques sans nicotine et à l'absence de traitement. Les effets secondaires sont le plus souvent bénins, et les données sur la sécurité à long terme restent limitées. Ces résultats s'appliquent uniquement aux produits réglementés et justifient un usage encadré dans une logique de réduction des risques.
La mise à jour 2025 de la revue Cochrane a inclus 90 études achevées (dont 49 essais randomisés) représentant 29 044 participants. Elle conclut que :
- Les cigarettes électroniques contenant de la nicotine augmentent significativement les taux d'arrêt du tabac par rapport :
- aux substituts nicotiniques (RR 1,59 ; IC95 % : 1,30–1,93 ; données de haute certitude).
- aux cigarettes électroniques sans nicotine (RR 1,46 ; IC95 % : 1,09–1,96 ; données de certitude modérée).
- au soutien comportemental seul ou à l'absence de traitement (RR 1,96 ; IC95 % : 1,66–2,32 ; données de faible certitude).
- En données absolues, cela représente entre 3 et 6 arrêts supplémentaires pour 100 fumeurs selon la comparaison.
- Il n’y a pas de différence significative concernant les effets indésirables (EI) non graves entre la CE avec nicotine et les comparateurs, mais les données sur les effets indésirables graves (EIG) restent limitées (niveau de preuve faible à très faible).
- Les effets secondaires les plus fréquents sont une irritation oro-pharyngée, toux, maux de tête et nausées, généralement transitoires.
- Les produits testés dans ces études sont réglementés et ne doivent pas être confondus avec les produits illicites ou contenant du THC.
«Les données actuellement disponibles indiquent avec un niveau de confiance élevé que les cigarettes électroniques contenant de la nicotine sont plus efficaces que les traitements de substitution nicotinique pour favoriser l’arrêt du tabac à six mois. Toutefois, les effets à long terme sur la santé restent mal connus. Nous recommandons que les cigarettes électroniques soient envisagées, dans un cadre de réduction des risques, uniquement avec des produits réglementés, sous encadrement médical, et en complément d’un accompagnement comportemental. Des études complémentaires sont nécessaires pour évaluer leur sécurité à long terme.»
Risques associés à la cigarette électronique
La littérature scientifique sur la toxicité des cigarettes électroniques reste incomplète, avec peu d’études de grande envergure et un manque de recul sur les effets à long terme. Si elle est souvent perçue comme une alternative moins nocive au tabac, en raison de l’absence de combustion, de monoxyde de carbone (CO) et de goudrons, elle n’est pas pour autant dénuée de risques. Les médecins doivent connaître ces risques pour informer leurs patients et encadrer l’usage de la cigarette électronique dans une stratégie de sevrage tabagique. Voici une analyse détaillée des risques sanitaires, environnementaux et sociétaux, basée sur les évidences scientifiques et les recommandations des autorités sanitaires.
1. Risques sanitaires
a. Risques respiratoires
Épidémiologie : L’étude PATH (Population Assessment of Tobacco and Health, 2020-2024) montre une augmentation de 30 à 40 % des symptômes respiratoires (dyspnée, toux, bronchite chronique) chez les vapoteurs exclusifs, particulièrement chez les jeunes adultes. Une association avec l’aggravation de la BPCO et de l’asthme est également rapportée.
Mécanismes : L’inhalation d’aérosols contenant du propylène glycol, de la glycérine végétale et des arômes chauffés peut provoquer une inflammation des voies respiratoires. Le diacétyle, un arôme utilisé dans certains e-liquides, est lié à la bronchiolite oblitérante (« poumon popcorn »).
EVALI : L’épidémie de lésions pulmonaires aiguës (EVALI, 2019, États-Unis) a causé 2 800 hospitalisations, liées à l’usage de produits non conformes contenant de l’acétate de vitamine E et du THC. Bien que rare en Europe grâce à une réglementation stricte (normes AFNOR, limite de nicotine à 20 mg/ml), des symptômes respiratoires inexpliqués doivent alerter.
b. Risques cardiovasculaires
Données : L’American Heart Association (2023-2025) rapporte que le vapotage entraîne :
- Une augmentation transitoire de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque.
- Une dysfonction endothéliale et un stress oxydatif, exacerbés chez les patients à risque (hypertension, antécédents d’infarctus).
Mécanismes : La nicotine, surtout sous forme de sels (absorption rapide), provoque une vasoconstriction aiguë. Les particules fines (PM2.5) et les métaux lourds (nickel, plomb) présents dans l’aérosol peuvent contribuer à l’athérosclérose à long terme.
Populations à risque : Les patients avec des comorbidités cardiovasculaires (ex. : coronaropathie) nécessitent une surveillance accrue (ECG, tension artérielle) si la cigarette électronique est utilisée.
c. Risques cancérogènes
Évidences : Les e-liquides contiennent des composés potentiellement cancérogènes (formaldéhyde, acétaldéhyde) à des concentrations 10 à 450 fois inférieures à celles de la fumée de tabac (Goniewicz, 2014). Des études (Franco, 2016 ; Welz, 2016) suggèrent un risque accru de cancers des voies respiratoires supérieures en cas d’usage prolongé, mais aucun lien clair n’est établi pour d’autres cancers.
Comparaison : Pour les fumeurs passant à la cigarette électronique, le risque de cancer est réduit, mais non nul. Chez les non-fumeurs, tout usage est déconseillé en raison de l’exposition inutile à ces composés.
d. Dépendance à la nicotine
Mécanismes : Les sels de nicotine, utilisés dans les dispositifs modernes, ont une biodisponibilité élevée, renforçant le potentiel addictif, particulièrement chez les adolescents (American Heart Association, 2025). Le pic plasmatique rapide imite celui des cigarettes, maintenant la dépendance.
Jeunes : L’étude PATH montre une transition fréquente du vapotage au tabagisme chez les adolescents, favorisée par des arômes attrayants (fruits, bonbons) et le marketing ciblé. Environ 30 % des 15-24 ans ont essayé la cigarette électronique en France (Santé Publique France, 2023).
Vapofumage : 45 % des vapoteurs combinent tabac et cigarette électronique (SPLF, 2025), annulant les bénéfices de réduction des risques et entretenant la dépendance.
e. Effets neurodéveloppementaux
Adolescents : La nicotine peut interférer avec le développement cérébral, affectant la mémoire, l’attention et la régulation émotionnelle (données expérimentales, WHO, 2024).
Grossesse : La nicotine est fœtotoxique, augmentant les risques de fausses couches, retard de croissance intra-utérin (RCIU) et prématurité. Les effets des autres composants (propylène glycol, arômes) sont inconnus, rendant la cigarette électronique contre-indiquée chez les femmes enceintes (HAS, 2023).
f. Effets indésirables
Fréquence : La revue Cochrane (2025) rapporte des effets bénins chez 20-30 % des utilisateurs (irritation oro-pharyngée, toux, maux de tête, nausées), similaires aux TSN. Les effets graves (ex. : pneumopathies) sont rares, mais sous-étudiés.
Signalement : Les médecins doivent déclarer tout effet indésirable via le portail Signalement-Santé (www.signalement-sante.gouv.fr) (www.signalement-sante.gouv.fr), en particulier les symptômes respiratoires inexpliqués (risque EVALI-like).
2. Risques environnementaux
Déchets électroniques : Les cigarette électroniques jetables (« puffs »), interdites en France depuis février 2025, génèrent des déchets non recyclables (batteries lithium, plastiques). Les dispositifs rechargeables réduisent cet impact, mais l’aérosol émis contient des particules fines toxiques (PM2.5), contribuant à la pollution de l’air intérieur.
Impact écologique : La production et l’élimination des e-liquides et dispositifs impliquent des métaux rares (cobalt, nickel), posant des défis environnementaux. Les médecins doivent encourager l’usage de dispositifs rechargeables conformes pour limiter cet impact.
3. Risques sociétaux
Attraction des jeunes : La cigarette électronique, avec ses arômes sucrés et son design attractif, est un vecteur d’initiation à la nicotine chez les mineurs (30 % des 15-24 ans ont vapoté, Santé Publique France, 2023). L’interdiction des puffs vise à réduire cet attrait, mais le marketing en ligne reste un défi.
Normalisation du geste : Le vapotage reproduit les gestes du tabagisme, risquant de banaliser la consommation de nicotine dans les espaces publics, malgré l’extension des zones non-fumeurs (plages, parcs, juillet 2025).
Inégalités sociales : Le vapotage est plus fréquent chez les populations défavorisées (6,8 % chez les faibles revenus vs 5,4 % chez les revenus élevés), reflétant les inégalités du tabagisme (28,9 % chez les faibles revenus, Santé Publique France, 2023).
4. Comparatif des risques : cigarette électronique vs cigarette combustible
| Aspect | Cigarette combustible | Cigarette électronique |
|---|---|---|
| Agents toxiques | Goudrons, CO, benzène, arsenic | Particules fines, aldéhydes, métaux lourds (faibles doses) |
| Risques respiratoires | Cancers pulmonaires, BPCO | Bronchite chronique, dyspnée, aggravation BPCO |
| Risques cardiovasculaires | Infarctus, AVC, HTA | Vasoconstriction, stress oxydatif |
| Dépendance | Très forte (pic rapide) | Forte (sels de nicotine) |
| Risque jeunes | Initiation précoce, passerelle | Attractivité élevée, transition vers tabac |
| Grossesse | Fausses couches, RCIU, prématurité | Nicotine fœtotoxique, effets autres composants inconnus |
| Environnement | Mégots toxiques, pollution air | Déchets lithium/plastique, aérosols toxiques |
Sevrage tabagique et Cigarette électronique : Conduite à tenir pour les médecins
L’accompagnement des patients dans le sevrage tabagique, y compris ceux utilisant ou souhaitant utiliser la cigarette électronique (cigarette électronique), nécessite une approche structurée, personnalisée et basée sur les recommandations des autorités sanitaires françaises (HAS, HCSP, SPLF). Voici les étapes clés pour guider les médecins dans leur pratique, en tenant compte des données scientifiques et des contraintes réglementaires.
-
Évaluation initiale du patient
- Dépendance nicotinique : Utiliser le test de Fagerström pour quantifier le degré de dépendance (score 0-10). Un score ≥ 7 indique une forte dépendance, justifiant des interventions intensives.
- Motivation et obstacles : Évaluer la motivation à l’arrêt via un entretien motivationnel (échelle de 1 à 10) et identifier les déclencheurs (stress, habitudes sociales, etc.).
- Comorbidités : Rechercher des pathologies associées (BPCO, maladies cardiovasculaires, cancers) nécessitant un arrêt urgent du tabac.
- Historique tabagique et vapotage : Noter la consommation quotidienne (cigarettes/jour, mg de nicotine dans les e-liquides), l’usage actuel ou passé de la cigarette électronique, et la présence de vapofumage (usage concomitant de tabac et de vape, observé chez 45 % des vapoteurs selon la SPLF, 2025).
- État psychologique : Utiliser le questionnaire HAD (Hospital Anxiety and Depression) pour dépister anxiété ou dépression, facteurs de risque de rechute.
- Mesure initiale : Effectuer une mesure du monoxyde de carbone (CO) expiré (piCO Smokerlyzer, seuil normal < 6 ppm) pour évaluer l’exposition au tabac.
-
Information éclairée du patient
- Recommandations officielles : Informer que les substituts nicotiniques (TSN) (patchs, gommes, pastilles, inhalateurs) et la varénicline sont les traitements de première intention, validés par la HAS (2023) et remboursés à 65 % par l’Assurance Maladie. La cigarette électronique n’est pas recommandée comme traitement standard en raison d’un manque de données à long terme (HAS, HCSP).
- Bénéfices relatifs de la vape : Expliquer que la cigarette électronique est moins nocive que le tabac (10 à 450 fois moins de toxines, Goniewicz 2014), mais expose à des risques respiratoires (bronchite, dyspnée, PATH 2020-2024), cardiovasculaires (vasoconstriction, American Heart Association 2025), et à une dépendance aux sels de nicotine.
- Risques spécifiques :
- Jeunes : Risque d’initiation à la nicotine et de transition vers le tabac.
- Femmes enceintes : Nicotine fœtotoxique, déconseillée.
- Non-fumeurs : Aucun bénéfice, risque de dépendance.
- Vapofumage : Annule les bénéfices de réduction des risques.
- Incertitudes : Souligner le manque de données sur les effets à long terme (cancers, BPCO) et les risques liés aux arômes ou métaux lourds dans les e-liquides.
-
Stratégie thérapeutique individualisée
- Première intention :
- Prescrire des TSN adaptés au score de Fagerström (ex. : patch 21 mg/24h pour forte dépendance + gommes 4 mg pour cravings). Associer à des thérapies cognitivo-comportementales (TCC) pour gérer la dépendance psychologique.
- Envisager la varénicline (1 mg x 2/j après titration) ou le bupropion (150 mg x 2/j) pour les patients fortement dépendants, après évaluation des contre-indications (ex. : troubles psychiatriques pour bupropion).
- Option secondaire – Cigarette électronique :
- Indications :
- Échec ou intolérance aux TSN/varénicline (ex. : irritation cutanée, nausées).
- Forte dépendance (Fagerström ≥ 7) avec préférence exprimée pour la vape.
- Comorbidités cardio-pulmonaires (BPCO, post-infarctus) nécessitant une réduction immédiate de l’exposition au CO et aux goudrons.
- Contre-indications : Femmes enceintes, mineurs, non-fumeurs.
- Choix du dispositif :
- Privilégier des systèmes ouverts rechargeables conformes aux normes CE (ex. : AFNOR XP D90-300).
- Éviter les puffs (interdites depuis février 2025) et les mélanges artisanaux (« do it yourself ») en raison de risques non contrôlés (ex. : EVALI lié à l’acétate de vitamine E).
- Dosage initial : 1 mg de nicotine par cigarette fumée/jour (ex. : 20 mg/ml pour 20 cigarettes/jour).
- Objectif : Arrêt complet du tabac et de la nicotine en 6-12 mois, avec réduction progressive du dosage nicotinique (ex. : diminution de 2-4 mg/ml toutes les 2-4 semaines).
- Association thérapeutique : Combiner un patch TSN (dépendance de fond) avec une cigarette électronique (cravings aigus) pour les patients très dépendants, sous réserve d’un suivi rapproché.
-
Suivi et accompagnement pluridisciplinaire
- Fréquence : Consultation mensuelle minimum pendant 6 mois, puis trimestrielle jusqu’à l’arrêt complet.
- Paramètres à surveiller :
- CO expiré : Mesurer systématiquement pour confirmer l’abstinence tabagique (< 6 ppm).
- Santé respiratoire : Spirométrie tous les 3-6 mois pour les patients avec BPCO ou symptômes respiratoires (dyspnée, toux).
- Santé cardiovasculaire : Tension artérielle, ECG pour les patients à risque (antécédents d’infarctus, hypertension).
- Dépendance : Évaluer la consommation de nicotine (ml/jour, mg/ml) et ajuster pour éviter le vapofumage.
- Suivi pluridisciplinaire :
- Tabacologue : Élaborer une stratégie personnalisée, ajuster les doses.
- Psychologue : TCC pour gérer les déclencheurs et prévenir les rechutes.
- Pharmacien : Conseiller sur les TSN et vérifier la conformité des e-liquides.
- Infirmier : Éducation thérapeutique, suivi des progrès.
- Ligne Tabac Info Service : Soutien téléphonique (3989) ou via application (ex. : QuitNow, validée par SPF).
- Outils numériques : Recommander des applications de suivi du sevrage (ex. : Tabac Info Service) ou carnets CO connectés pour motiver les patients.
-
Déclaration des effets indésirables
- Tout effet indésirable (ex. : toux persistante, dyspnée, palpitations) doit être signalé via le portail Signalement-Santé (www.signalement-sante.gouv.fr) (www.signalement-sante.gouv.fr).
- Surveiller les signes d’EVALI-like (dyspnée aiguë, fièvre, symptômes inexpliqués), rares en Europe mais liés à des produits non conformes.
-
Points de vigilance
- Vapofumage : Identifier et décourager l’usage dual (tabac + vape), inefficace pour réduire les risques (SPLF, 2025).
- Jeunes : Éviter les arômes sucrés (fruits, bonbons) pour limiter l’attrait et le risque de dépendance.
- Qualité des produits : Vérifier la conformité des e-liquides (normes AFNOR, absence de THC ou additifs non autorisés).
- Populations à risque :
- BPCO : La vape réduit l’exposition aux goudrons, mais peut aggraver les symptômes respiratoires (PATH, 2020-2024).
- Maladies cardiovasculaires : Surveiller la pression artérielle et les signes de vasoconstriction.
- Grossesse : Contre-indiquée, privilégier les TSN sous suivi médical.
-
Messages clés à transmettre aux patients
- « La meilleure option est l’arrêt complet du tabac et de la nicotine, avec des méthodes validées comme les patchs ou la varénicline. »
- « La cigarette électronique est moins toxique que le tabac, mais comporte des risques (poumons, cœur, dépendance) et doit être temporaire. »
- « Ne combinez pas tabac et vape, et utilisez uniquement des produits conformes sous suivi médical. »
-
Outils pratiques pour la consultation
- Évaluation : Test de Fagerström, questionnaire HAD, mesure CO expiré (piCO Smokerlyzer).
- Choix du dispositif : Systèmes ouverts rechargeables, e-liquides certifiés CE, dosage adapté (ex. : 12-20 mg/ml selon dépendance).
- Trajectoire de sevrage : Réduire la nicotine tous les 15-30 jours (ex. : 20 mg/ml → 12 mg/ml → 6 mg/ml → 0 mg/ml).
- Support : Applications validées (Tabac Info Service), carnets de suivi, orientation vers Tabac Info Service (3989).
Organigramme décisionnel
|
Situation clinique |
Décision |
Actions |
|
Première consultation, fumeur motivé |
TSN + TCC |
Prescrire patch/gomme, orienter vers psychologue, suivi à 1 mois. |
|
Échec TSN/varénicline, forte dépendance |
Considérer cigarette électronique |
Dispositif rechargeable, dosage adapté, suivi CO/spiro, réduction nicotine. |
|
Comorbidités cardio-pulmonaires |
Vape si TSN refusé |
Surveillance ECG/spiro, objectif arrêt 6-12 mois, éviter vapofumage. |
|
Femme enceinte, mineur, non-fumeur |
Contre-indiqué |
TSN (grossesse), TCC (jeunes), aucune nicotine (non-fumeurs). |
Suivi pluridisciplinaire pour les patients vapoteurs dans le cadre du sevrage tabagique
Le suivi pluridisciplinaire est essentiel pour accompagner les patients vapoteurs dans leur démarche de sevrage tabagique, en raison de la complexité de la dépendance à la nicotine, qui combine des aspects physiologiques, psychologiques et comportementaux. Une équipe composée de médecins, de psychologues, de pharmaciens et de conseillers spécialisés permet de proposer une prise en charge globale et personnalisée. Les médecins évaluent les besoins médicaux, prescrivent des substituts nicotiniques ou des traitements comme la varénicline, et surveillent les éventuelles comorbidités, tandis que les pharmaciens conseillent sur l’utilisation sécurisée des aides pharmacologiques. Cette coordination, appuyée par des recommandations cliniques, améliore les chances de succès, notamment pour les vapoteurs qui peuvent être des fumeurs duaux ou avoir des profils variés, comme les jeunes ou les femmes enceintes.
Les aspects psychologiques et comportementaux sont tout aussi importants, car la vapote peut reproduire des gestes et des routines associés au tabagisme, rendant le sevrage difficile. Les psychologues jouent un rôle clé en proposant des thérapies cognitivo-comportementales (TCC) pour gérer les envies et identifier les déclencheurs, tandis que les conseillers en sevrage tabagique offrent un soutien motivant et des stratégies pour prévenir les rechutes. Une étude publiée dans Preventive Medicine Reports (2023) souligne l’importance de combiner ces interventions pour les vapoteurs, en évaluant leur dépendance et en adaptant les approches à leurs besoins spécifiques, qu’il s’agisse de réduire la consommation ou d’arrêter complètement.
Enfin, la collaboration interdisciplinaire permet de répondre aux défis spécifiques posés par l’usage dual (tabac et vapote) et aux incertitudes sur les effets à long terme de la vapote. Les infirmiers, par exemple, peuvent assurer le suivi des progrès et l’éducation des patients, tandis que les lignes d’assistance comme Tabac Info Service en France offrent un soutien accessible.
Conclusion
La cigarette électronique n’est pas un traitement de première intention, mais peut être une option encadrée pour des patients réfractaires aux TSN ou très dépendants, avec un suivi rigoureux. Les médecins doivent privilégier les approches validées, surveiller les risques (respiratoires, cardiovasculaires, dépendance) et viser un arrêt total. Les recherches en cours préciseront son rôle à l’avenir.
Références
- Haute Autorité de Santé (HAS). Recommandations pour l’arrêt du tabac en soins de premier recours. Juin 2023.https://www.has-sante.fr
- Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP). Avis relatif aux systèmes électroniques de délivrance de nicotine (SEDEN). Novembre 2022.https://www.hcsp.fr
- Société de Pneumologie de Langue Française (SPLF). Sevrage tabagique et cigarette électronique : où en est-on ? Session Tabac et toxiques inhalés, juin 2025.https://www.splf.fr
- Lindson N. et al. Electronic cigarettes for smoking cessation. Cochrane Database of Systematic Reviews. Janvier 2025. Issue 1. Art. No.: CD010216. DOI :10.1002/14651858.CD010216.pub9
- Organisation mondiale de la Santé (OMS). Traitement clinique du sevrage tabagique chez l’adulte. Juillet 2024.https://www.who.int
- American Heart Association. Vaping and Cardiovascular Health: Scientific Statement. 2023.https://www.heart.org
- PATH Study (Population Assessment of Tobacco and Health). NIH-FDA, rapports 2020–2024.https://pathstudyinfo.nih.gov
- Santé publique France. Baromètre santé 2023 – Tabac et vapotage. 2024.https://www.santepubliquefrance.fr
- Public Health England. Evidence review of e-cigarettes and heated tobacco products. 2021.https://www.gov.uk
- National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Tobacco: preventing uptake, promoting quitting and treating dependence. 2021.https://www.nice.org.uk
- Ministry of Health (New Zealand). Vaping facts and regulations. 2024.https://www.health.govt.nz
- Food and Drug Administration (FDA). Youth Tobacco Prevention Plan. 2023.https://www.fda.gov
- Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ). E-cigarettes: what we know. 2023.https://www.dkfz.de
- Santé Canada. Tobacco and Vaping Products Act. 2023.https://www.canada.ca
- Goniewicz ML et al. Levels of selected carcinogens and toxicants in vapour from electronic cigarettes. Tob Control. 2014;23(2):133–139.
- Franco T et al. Cancer risk and electronic cigarette use: a review. Respir Res. 2016;17(1):1–9.
- Welz C et al. E-cigarettes and cancer risk: current perspectives. J Cancer Res Clin Oncol. 2016;142(4):653–662.
- Preventive Medicine Reports. Multi-component behavioral interventions for e-cigarette users: effectiveness and perspectives. 2023.https://www.sciencedirect.com
- Tobacco Control. Systematic review on vaping cessation support. Février 2025.https://tobaccocontrol.bmj.com
- Journal of the American College of Cardiology (JACC). Pathways for tobacco cessation management. 2018.https://www.jacc.org
Descripteur MESH : Électronique , Sevrage , Sevrage tabagique , Tabac , Santé , Nicotine , France , Tabagisme , Patients , Risque , Médecins , Santé publique , Mortalité , Femmes , Mineurs , Femmes enceintes , Dyspnée , Association , Intention , Canada , Toux , Thérapeutique , Face , Sécurité , Rôle , Sels , Métaux , Toxiques , Métaux lourds , Conseil , Vasoconstriction , Goudrons , Pharmaciens , Population , Langue , Arrêt du tabac , Carbone , Motivation , Monoxyde de carbone , Tête , Infarctus , Europe , Pression , Grossesse , Propylène glycol , Maladies cardiovasculaires , Logique , Marketing , Hypertension artérielle , Maladie