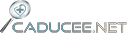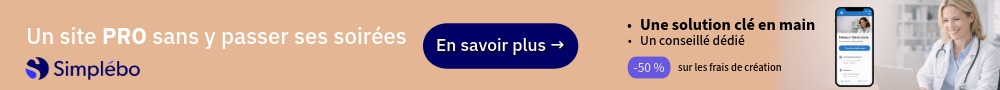Leçons d'Ukraine : quand la télémédecine sauve des vies en temps de guerre

Des préparatifs français inspirés par la réalité ukrainienne
Face aux tensions géopolitiques croissantes en Europe, le ministère français de la Santé a émis, le 18 juillet 2025, une instruction confidentielle aux Agences Régionales de Santé (ARS) pour préparer les hôpitaux à un afflux massif de blessés militaires – jusqu'à 50 000 – d'ici mars 2026. Cette mesure a été qualifiée de « prudence » par la ministre Catherine Vautrin. Elle vise à transformer les établissements civils en bases arrière, en anticipant une raréfaction des ressources similaire à celle observée en Ukraine depuis l'invasion russe de février 2022. Mais au-delà de ces directives nationales, les leçons tirées du conflit ukrainien offrent un cadre précieux pour les professionnels de santé européens. Des rapports de The Lancet et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) soulignent comment les transferts de blessés ukrainiens ont mis à l’épreuve les systèmes allemands et français, et révélé l'intérêt de la télémédecine comme vecteur de résilience des soignants en temps de guerre.
Ces transferts, coordonnés par l’Union européenne via son mécanisme de protection civile, ont impliqué plus de 3 700 patients ukrainiens évacués vers 22 pays européens depuis 2022, dont l’Allemagne et la France.[1] Ils ont testé la capacité d’accueil des hôpitaux occidentaux. Ils ont aussi mis en lumière des pratiques innovantes adaptées aux zones de guerre, particulièrement en télémédecine. Pour les médecins, infirmiers et autres professionnels de santé, ces enseignements représentent une opportunité de se préparer proactivement, sans attendre une escalade.
Les transferts de blessés ukrainiens : un test grandeur nature pour les systèmes européens
Depuis le début de la guerre, l’OMS a documenté plus de 1 986 attaques sur les infrastructures de santé ukrainiennes. Ces attaques ont entraîné la destruction de cliniques, la mort de 428 soignants et des blessures pour 189 autres.[2] Face à cette catastrophe, l’UE a mis en place un système d’évacuation médicale (medevac) qui a permis le transfert de milliers de patients vers des hôpitaux spécialisés en Europe. En août 2022, déjà 1 000 patients avaient été accueillis dans 18 pays ; ce chiffre a grimpé à plus de 3 000 en janvier 2024, et dépasse les 3 700 en septembre 2024.[3][4][1] L’Allemagne, en tant que principal récepteur, a pris en charge des centaines de cas graves, incluant des blessés de guerre nécessitant des soins en traumatologie et en rééducation. La France, quant à elle, a participé activement via des hôpitaux comme ceux de l’Assistance Publique–Hôpitaux de Paris (AP-HP), accueillant des patients pour des traitements spécialisés en chirurgie reconstructive et en gestion de contaminations.
Ces opérations ont mis à rude épreuve les systèmes européens. Une analyse publiée en 2024 dans The Lancet sur la manière dont les structures sanitaires ont répondu aux effets conjoints de la guerre et des flux de réfugiés souligne de fortes tensions sur les ressources. Le rapport décrit en particulier la saturation des unités de soins intensifs, les obstacles linguistiques et culturels rencontrés dans la prise en charge, ainsi que l’accroissement marqué des besoins en santé mentale chez les populations réfugiées.[5]
En Allemagne, par exemple, les hôpitaux bavarois ont dû adapter leurs protocoles pour gérer des blessures balistiques inhabituelles en temps de paix. En France, les transferts ont testé la coordination civilo-militaire, écho aux préparatifs actuels des ARS. L’OMS, dans son rapport sur les leçons médicales de l’Ukraine (juin 2025), insiste sur la nécessité d’améliorer les opérations d’évacuation, en partenariat avec l’UE, pour inclure des retours volontaires de patients une fois stabilisés.[2][6]
Ces flux de patients ont également révélé des vulnérabilités structurelles : un article de The Lancet (décembre 2024) décrit comment la pression exercée sur le système de santé ukrainien se répercute sur l’Europe à travers le risque d’épidémies et de pénuries de médicaments.[7]
Pour les professionnels de santé en France comme en Allemagne, ces expériences rappellent l’impérieuse nécessité de constituer des équipes multidisciplinaires, aptes à prendre en charge des afflux massifs de patients tout en préservant la continuité des soins destinés aux civils.
La télémédecine comme ligne de vie en zone de guerre
Au cœur des leçons ukrainiennes figure la télémédecine, qui s’est imposée comme une « ligne de vie » pour le système de santé en zone de conflit.[8] Face à la destruction des infrastructures, des initiatives comme TeleHelp Ukraine – un réseau décentralisé lancé en 2022 par des médecins américains et ukrainiens – ont permis de connecter des patients isolés à des experts internationaux via des consultations virtuelles.[9][10] Ce programme, soutenu par Stanford Medicine, a traité des cas de diabète, de traumatismes psychologiques et de blessures chroniques, démontrant que la télémédecine réduit les besoins en évacuations physiques tout en offrant un soutien psychologique aux soignants sur le terrain.
Un article de Frontiers in Medicine (2024) explore les perspectives et barrières de la télémédecine en zones de guerre, notant son rôle dans le traitement des soldats blessés et le soutien mental face au stress post-traumatique.[11] En Ukraine, des plateformes comme celles développées par l’OMS et des ONG ont permis des diagnostics à distance, évitant les déplacements risqués dans des zones bombardées. Pour les professionnels européens, ces innovations sont directement transposables : consultations virtuelles pour trier les blessés avant transfert, ou formations en ligne pour la traumatologie de combat, comme celles testées en Allemagne pour les réfugiés ukrainiens.
The Lancet souligne également, dans un commentaire de 2023 sur la couverture santé universelle en Ukraine, comment la télémédecine a aidé à maintenir les progrès vers une UHC (Universal Health Coverage) malgré la guerre, en intégrant des outils numériques pour la continuité des soins.[12] Selon Diabetes Spectrum (2024), la télémédecine a joué un rôle décisif dans la prise en charge du diabète en zone de conflit : les consultations virtuelles ont permis d’ajuster les traitements insuliniques à distance et d’éviter des décès..[13]
En France, cette stratégie pourrait s’aligner sur les simulations OTAN pour former les soignants à des scénarios hybrides (guerre pandémie). Des barrières persistent – cybersécurité, accès internet en zones dégradées – mais des solutions existent, comme les réseaux décentralisés de TeleHelp Ukraine.[14]
Trois usages de la télémédecine en zones de guerre
- Triage virtuel des blessés : utiliser la visioconsultation pour évaluer la gravité des cas avant transfert hospitalier.
- Formations à distance : développer des modules en ligne de traumatologie et de soins d’urgence inspirés des pratiques de guerre.
- Suivi des maladies chroniques : mettre en place des consultations régulières par télé-expertise pour le diabète ou l’hypertension, afin d’assurer la continuité des soins en situation de crise.
Vers une résilience proactive pour les soignants européens
Les leçons de l’Ukraine, documentées par The Lancet et l’OMS, transcendent les frontières : les transferts de blessés ont mis à l’épreuve les systèmes de soins français et allemands, tout en accélérant le recours à la télémédecine, devenue un levier indispensable pour une Europe en alerte. Pour les professionnels de santé, l’enjeu est immédiat : se former aux plateformes virtuelles, promouvoir les investissements dans des infrastructures numériques sécurisées et intégrer ces outils aux pratiques cliniques courantes. Ainsi, en cas « d’engagement majeur », les soignants ne se limiteront pas à une réponse réactive, mais pourront incarner les acteurs d’une médecine résiliente. Comme l’affirme un rapport OMS, « il n’y a pas de frontières » en matière de soins en temps de crise.[15]
Références
- EU Medevac Operations in Ukraine: Update as of September 2024. European Commission.
- WHO Surveillance System for Attacks on Health Care in Ukraine, June 2025. World Health Organization.
- EU Civil Protection Mechanism: Medical Evacuations from Ukraine, August 2022 Report. European Commission.
- Medevac Progress Report: Over 3,000 Patients Transferred, January 2024. European Commission.
- The Lancet: Health System Responses to War and Displacement in Europe, 2024. The Lancet Journal.
- WHO Lessons from Ukraine: Improving Evacuation Operations, June 2025. World Health Organization.
- The Lancet: Pressures on Ukrainian Health System and European Impacts, December 2024. The Lancet Journal.
- Telemedicine as a Lifeline in Conflict Zones: Ukraine Case Study. Various Sources, 2024.
- TeleHelp Ukraine Initiative: Overview and Impact, 2022–2024. Stanford Medicine.
- TeleHelp Ukraine: Network Details. Stanford Medicine.
- Frontiers in Medicine: Telemedicine in War Zones, 2024. Frontiers Journal.
- The Lancet: Universal Health Coverage in Ukraine Amid War, 2023. The Lancet Journal.
- Diabetes Spectrum: Telemedicine for Diabetes Management in Frontlines, 2024. Diabetes Spectrum Journal.
- TeleHelp Ukraine: Decentralized Networks Solutions. Stanford Medicine.
- WHO Report: No Borders in Crisis Care, 2025. World Health Organization.
Descripteur MESH : Ukraine , Télémédecine , Temps , Santé , Patients , France , Hôpitaux , Face , Lumière , Guerre , Soins , Europe , Allemagne , Continuité des soins , Traumatologie , Diabète , Transfert , Solutions , Médecins , Rôle , Réfugiés , Réseau , Mort , Paris , Directives , Commentaire , Soins intensifs , Investissements , Hôpitaux spécialisés , Risque , Unités de soins intensifs , Conjoints , Médecine , Infirmiers , Internet , Vie , Nature , Santé mentale , Expertise , Protection civile , Mars , Pression