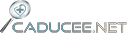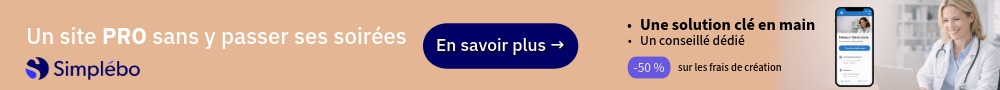Loi Garot et déserts médicaux : faut-il faire payer les jeunes médecins pour leurs études ?

Formation subventionnée : une dette morale ou un investissement public ?
Ce que disent les professeurs Payen : Didier et Jean-François Payen considèrent qu’il est "logique" de demander aux jeunes médecins une redevance d’exercice en début de carrière. Selon eux, les études médicales sont fortement subventionnées par l’État — entre 15 000 et 20 000 euros par an, sur dix à douze ans — ce qui représente un coût considérable pour la collectivité.
Ils soulignent que, contrairement à d’autres filières onéreuses, comme les écoles de commerce, les études de médecine en France restent quasi gratuites. Dans un contexte où l’accès aux soins devient inégal, ils estiment que les médecins devraient faire un effort de solidarité territoriale. Pour eux, cette redevance ne serait pas une punition, mais un "engagement modeste" en reconnaissance de la qualité de la formation reçue.
La réponse de Reagjir :« Messieurs les PU-PH, les jeunes médecins n’ont pas de leçons à recevoir de vous ! », lancent-ils en ouverture de leur tribune. Le syndicat des jeunes médecins balaie l’argument comme un "non-sens". Ils rappellent que les internes jouent un rôle central dans les services hospitaliers, assurant des soins au quotidien tout en poursuivant leur formation. Cette implication, largement sous-évaluée, permettrait selon plusieurs rapports de générer une économie allant jusqu’à 366 000 euros par interne pour l'État, compensant ainsi en grande partie les frais engagés pour leur formation.
Ils dénoncent une double peine : être mal rémunérés (entre 8 et 9 €/h), travailler jusqu’à 60 heures par semaine, et se voir ensuite reprocher de ne pas assez "rendre à la société". Le syndicat évoque aussi les conditions psychologiques délétères auxquelles sont confrontés les internes, avec 66 % d’entre eux souffrant de burn-out, 27 % présentant des épisodes dépressifs caractérisés, et un suicide recensé tous les 18 jours. Ces chiffres, issus d’enquêtes menées par les organisations représentatives des internes, traduisent une situation de grande souffrance psychique et une profonde crise du système de formation médicale, marqué par un manque de reconnaissance, des surcharges chroniques de travail et une précarité persistante.
Faut-il encadrer la liberté d’installation ?
Position des PU-PH : Les professeurs Payen soutiennent que la liberté d’installation, restée intacte malgré les inégalités croissantes d’accès aux soins, n’est plus tenable. Ils pointent une répartition déséquilibrée des médecins, avec certains territoires désertés pendant que d’autres concentrent toujours plus de praticiens. Pour eux, les jeunes médecins refusent toute forme de contrainte alors qu’ils bénéficient d’un système privilégié. Le zonage mis en place dans d'autres professions paramédicales serait transposable à la médecine. « On ne peut pas continuer à former des médecins aux frais de la collectivité tout en les laissant s’installer librement dans les zones déjà saturées. Il en va de la cohésion du système de soins », déclarent-ils.
Position des jeunes praticiens : Reagjir défend une vision opposée. Selon le syndicat, les médecins généralistes sont déjà les professionnels de santé les mieux répartis sur le territoire. Contrairement aux idées reçues, 98 % des Français vivent à moins de dix minutes d’un cabinet médical. Ce maillage est d’autant plus remarquable qu’il s’effectue dans un contexte de baisse continue du nombre de généralistes libéraux, ce qui montre une capacité de résistance de la médecine de ville face aux déséquilibres structurels.
Le syndicat insiste sur le fait que les inégalités territoriales actuelles découlent davantage de la concentration des hôpitaux et des spécialités médicales dans les grandes métropoles. Les CHU et centres hospitaliers spécialisés continuent d’attirer les praticiens en quête de stabilité, de technique, ou de carrière académique, souvent au détriment des territoires moins dotés. Pour Reagjir, une régulation uniforme des installations libérales serait non seulement inefficace, mais risquerait aussi de dissuader les jeunes médecins de s’installer. Ils appellent plutôt à un rééquilibrage structurel du système de santé, qui passe par une réforme de la formation, une meilleure valorisation des soins de premier recours et une réorganisation des parcours professionnels dès les études médicales.
Comparaisons internationales : des modèles transposables ?
L’argument des professeurs : Les PU-PH évoquent le modèle canadien, où les médecins doivent, après leur formation, travailler plusieurs années dans des zones rurales ou nordiques, parfois sous peine de ne pas pouvoir exercer ailleurs. Ils mettent en avant des dispositifs similaires en Australie ou au Royaume-Uni, où les jeunes médecins acceptent une obligation territoriale en échange d’un accès facilité à la formation ou à des incitations financières substantielles. Selon eux, ces systèmes ont prouvé leur efficacité sans provoquer de rejet massif des professionnels concernés. Ils estiment que la France gagnerait à s’en inspirer, ne serait-ce que pour garantir un accès équitable aux soins sur l’ensemble du territoire : « Il ne s’agit pas de sanctionner, mais d’assumer collectivement la responsabilité de répondre aux besoins de la population. »
La réponse de Reagjir :« Comparer notre situation à celle de systèmes étrangers très centralisés revient à ignorer notre réalité : nous sommes formés dans un système libéral et déjà en difficulté », soulignent-ils. Les jeunes praticiens dénoncent une comparaison biaisée. Ils insistent sur le fait que ces exemples étrangers ne sauraient servir de modèle dans le contexte français, où le modèle libéral prédomine, et où les médecins sont déjà confrontés à des difficultés croissantes d’installation.
Selon eux, transposer ces obligations sans une réforme globale risquerait d’accentuer la crise d’attractivité des territoires fragiles.Ils rappellent que ces pays fonctionnent selon des systèmes de santé centralisés, où la majorité des médecins sont salariés. Imposer les mêmes contraintes dans le système libéral français, sans un soutien adapté ni une réforme d’ampleur, reviendrait à décourager encore plus l’installation en zones fragiles. Ils plaident pour des incitations et non des sanctions, et appellent à un changement de méthode plus que de modèle.
Et l’hôpital dans tout ça ?
Ce que Reagjir met en lumière : Le syndicat accuse les hôpitaux universitaires d’être les grands absents de la réforme. Alors que les CHU recrutent toujours dans les grandes métropoles, aucune mesure de régulation ne s’y applique. Reagjir estime que cette concentration alimente la désertification médicale, en monopolisant les postes, les stages, et les carrières universitaires dans les centres urbains. Ils proposent donc, avec ironie, d’imposer aux PU-PH eux-mêmes d’aller exercer dans les zones sous-dotées :« Rendez à la société ce qu’elle vous a donné », concluent-ils avec provocation. »
En écho à ces tensions, l’ancien ministre de la Santé Aurélien Rousseau a réagi publiquement à la tribune des professeurs Payen. Dans un message publié sur X (anciennement Twitter), il écrit : « Étrange de se placer sur ce terrain “moral”. Sauf si nous étions (et je prends ma part) collectivement irréprochables sur la vraie vie des internes : rôle dans les services, rémunération, encadrement… » Une prise de position qui rappelle que les responsabilités sont partagées et que les débats sur l’engagement des jeunes praticiens ne peuvent se détacher des conditions réelles dans lesquelles ils se forment et exercent.
Sortir des postures simplistes et recentrer le débat
Derrière la controverse autour de la redevance, c’est une fracture bien plus large qui se dessine : celle de deux visions de la médecine, deux rapports à l’engagement professionnel, et deux systèmes de référence. D’un côté, une parole professorale qui incarne une tradition hospitalo-universitaire centralisée, prônant une régulation au nom de la solidarité nationale. De l’autre, une génération de jeunes praticiens formés dans un système libéral, en proie à des conditions d’exercice éprouvantes, qui revendiquent une liberté professionnelle acquise au prix d'une contribution largement assumée.
La virulence des réactions, dans les tribunes comme dans les commentaires en ligne, illustre à la fois une fracture générationnelle et un ras-le-bol plus large du corps médical face à des injonctions perçues comme injustes ou déconnectées. Accuser les jeunes médecins d’ingratitude vis-à-vis de l’État, sans remettre en question les responsabilités historiques des institutions hospitalières et politiques dans la crise actuelle, revient à inverser les rôles et à déplacer le débat.
Les comparaisons internationales avancées — notamment avec les États-Unis ou le Royaume-Uni — manquent de rigueur analytique, en particulier lorsqu’elles émanent de personnalités académiques censées maîtriser les exigences de contextualisation. Ces systèmes éducatifs, sociaux et sanitaires, très éloignés du modèle français, ne peuvent servir de références directes sans tenir compte de leurs spécificités structurelles. Leur invocation sans nuance alimente une vision binaire et simpliste au risque de servir de point d’appui à certains discours populistes qui cherchent à sacrifier sur l'autel électoral le médecin libéral, et détournent le débat public de ses véritables enjeux structurels. C'était peut être là tout l'objet de cette tribune moralisatrice, clivante et si peu confraternelle.
Cette controverse, loin d’être marginale, questionne notre capacité collective à construire un pacte intergénérationnel équitable. Pour garantir un accès équitable aux soins, il faudra sortir des postures dogmatiques. Ni la stigmatisation, ni l’imposition ne feront revenir les médecins dans les zones fragiles. La réponse réside dans une réforme globale et partagée du système de santé, construite sur la reconnaissance mutuelle, un dialogue réel et des engagements réciproques.
Sources : Tribune des Prs Didier et Jean-François Payen, Le Monde, 7 mai 2025 – Tribune du syndicat Reagjir, Egora, 9 mai 2025.
Descripteur MESH : Médecins , Médecine , Liberté , Soins , Santé , Face , Rôle , Hôpitaux , France , Services hospitaliers , Hôpitaux universitaires , Discours , Vie , Professions , Australie , Rémunération , Population , Médecins généralistes , Corps médical , Logique , Commerce , Travail , Économie , Professions paramédicales , Virulence , Punition , Parole , Suicide , Risque