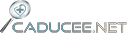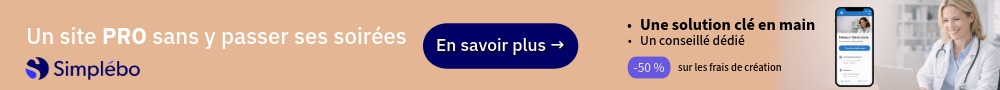Moins d’administration, plus de terrain : les mesures du rapport Rousset passées au crible des praticiens libéraux

Une crise démographique et systémique
Le rapport qualifie la crise de « systémique », avec des inégalités territoriales et sociales devenues, selon ses auteurs, « insoutenables ». Les chiffres sont parlants : en 2025, la France compte 241 255 médecins inscrits à l’Ordre, mais seuls 201 239 exercent effectivement, et les généralistes ne sont plus que 99 500, soit une baisse de 2,5 % depuis 2022. Le territoire est massivement sous-doté : 87 % des communes sont en sous-densité médicale, et 11 % relèvent d’un désert médical avancé. À Mayotte, on ne dénombre que neuf généralistes pour 100 000 habitants.
Ces pénuries ont des conséquences directes sur la pratique libérale. Le renoncement aux soins augmente, notamment dans les zones rurales et précaires, ce qui accentue la surcharge des cabinets existants. Selon les auditions de la commission, près de 70 % des passages aux urgences concernent des situations qui pourraient être prises en charge en ville. La santé mentale et la périnatalité illustrent également cette tension : 13 millions de Français seraient concernés par des troubles dépressifs, et la fermeture de 40 % des maternités depuis 1995 complexifie le suivi des patientes, augmentant le poids des consultations complexes pour les libéraux.
À cela s’ajoute une organisation jugée défaillante. Les ARS sont décrites comme « déconnectées » du terrain, produisant des plans dépassant parfois le millier de pages, sans effet réel sur le quotidien des praticiens. Dans le même temps, la médecine libérale ne représente que 13 % de la permanence des soins, accentuant le sentiment d’une concurrence inéquitable avec l’hôpital public. Enfin, la formation demeure archaïque : en 2024, la France ne comptait que 3 080 infirmiers en pratique avancée, un chiffre largement insuffisant face aux besoins. Le numerus clausus, devenu numerus apertus, n’a pas empêché la désertification.
Comme le souligne Jean-François Rousset dans ses conclusions, « nous avons construit une organisation qui épuise ses soignants et décourage ses étudiants ». Mathias Wargon, chef de service des urgences, auditionné par la commission, confirme ce constat en évoquant « un système à bout de souffle, où le burnout devient la norme ». Ce diagnostic, nourri d’exemples chiffrés et de témoignages, met en lumière une réalité déjà palpable pour de nombreux libéraux.
39 mesures pour alléger la pression sur les praticiens
Le rapport propose 39 mesures, inspirées de modèles étrangers comme l’Allemagne ou la Suède, pour bâtir une loi de programmation pluriannuelle. L’objectif est d’alléger la pression sur les praticiens et de rendre la médecine libérale plus attractive. Trois grands axes ressortent.
Gouvernance et organisation : moins de bureaucratie, plus de local
La suppression des agences régionales de santé, remplacées par un « sous-préfet santé » départemental, vise à rapprocher la décision des territoires. Les budgets du Fonds d’intervention régional (FIR) seraient déconcentrés, avec un tiers directement attribué au niveau départemental, et les contrats existants fusionnés dans des « contrats locaux de santé ». Le rapport recommande aussi d’actualiser les groupements hospitaliers de territoire (GHT) en y intégrant le secteur privé, et de lancer une loi de programmation des investissements sur cinq ans.
Pour les libéraux, ces mesures pourraient concrètement signifier des démarches administratives allégées : par exemple, des autorisations d’installation traitées directement au niveau départemental en quelques semaines plutôt qu’en plusieurs mois par les ARS. Elles devraient aussi renforcer la coordination locale, notamment via les CPTS, qui pourraient organiser plus efficacement la répartition des gardes et éviter aux praticiens isolés de supporter seuls la permanence des soins. Mais ces réformes ne sont pas exemptes d’obstacles : certains élus locaux auditionnés ont mis en garde contre la complexité de la décentralisation, qui pourrait générer une fragmentation et des doublons si les financements ne suivent pas.
Formation médicale : attractivité et reconversions facilitées
La durée des études serait réduite à huit ans, avec la suppression de la quatrième année de médecine générale. Le rapport plaide pour une voie par apprentissage dès la deuxième année et pour l’intégration de compétences en gestion et management. Les passerelles seraient élargies, permettant à des infirmiers en pratique avancée d’accéder plus rapidement aux études de médecine. La validation continue remplacerait une partie des examens actuels.
Ces changements pourraient, selon les auteurs, permettre la formation de 33 000 médecins supplémentaires en trois ans, en incluant les diplômés étrangers. Pour les libéraux, cela se traduirait par une arrivée plus rapide de jeunes confrères, mieux armés pour gérer un cabinet et plus enclins à s’installer. Mais certains redoutent une baisse de l’exigence académique. Lors de leur audition, des doyens de faculté ont souligné le défi de préserver la qualité de la formation avec un cursus accéléré, rappelant que « raccourcir n’est pas forcément former mieux ».
Inégalités territoriales et délégation de tâches : soulager la pénurie
Les aides à l’installation seraient resserrées sur les zones les plus en difficulté, avec une révision annuelle des zonages menée en lien avec les maires. Dans certaines régions, des montants allant jusqu’à 50 000 euros pourraient être mobilisés pour attirer de jeunes médecins, selon les auditions des ARS. Le rapport propose aussi de supprimer des certificats jugés inutiles, de revaloriser les indemnités des IPA et d’étendre leurs compétences, notamment en dépistage et orientation. Les PADHUE seraient intégrés via une régularisation au cas par cas. Enfin, la création d’une « Grande Sécurité sociale » est évoquée pour améliorer la solvabilité des patients précaires.
Dans la pratique libérale, cela pourrait libérer du temps médical, réduire la charge administrative et renforcer les équipes grâce à la délégation. Lors d’une mission dans le Grand Est, un médecin généraliste a témoigné que l’intégration d’une IPA dans sa CPTS avait permis de diminuer de 15 % ses consultations non programmées, réduisant ainsi sa charge hebdomadaire. Mais ces réformes exigent un financement clair et une réelle volonté politique pour éviter qu’elles ne restent lettre morte.
Public-privé et permanence des soins : rééquilibrer la charge
Le rapport souligne aussi la nécessité de mieux articuler les rôles entre hôpital et médecine de ville. Il propose de réguler plus strictement les centres de soins non programmés et de sanctionner les établissements privés qui ne participeraient pas à la permanence des soins. En contrepartie, une mutualisation des gardes, via les CPTS et les groupements hospitaliers de territoire, serait encouragée. Le rôle des sages-femmes serait revalorisé et celui des hôpitaux renforcé dans les parcours de soins.
Pour les libéraux, ces recommandations pourraient alléger la charge des urgences en répartissant plus équitablement les gardes entre public et privé. Elles offriraient aussi des perspectives de collaboration plus équilibrées avec les établissements hospitaliers. Mais certains redoutent que cette régulation accrue n’entraîne une pression supplémentaire sur des praticiens déjà épuisés. Comme l’a souligné le président de l’UFML Jérôme Marty lors de son audition, « on ne peut pas demander davantage à des médecins qui sont déjà au bord de la rupture ». De leur côté, plusieurs représentants syndicaux ont insisté sur le risque d’alourdir la charge de travail des libéraux si la mutualisation des gardes n’est pas accompagnée de moyens financiers et organisationnels adaptés. Des représentants de cliniques privées ont, eux, alerté sur une possible « désaffection » de leur participation si la régulation devenait trop contraignante.
Réactions et débats
Les propositions du rapport ont suscité de nombreux échanges lors des auditions menées par la commission. Plusieurs représentants syndicaux ont exprimé leur inquiétude. MG France a rappelé que « l’attractivité de la médecine générale ne peut se résumer à raccourcir les études », pointant le risque d’un effet contre-productif. La CSMF a insisté sur la nécessité de « garantir la qualité de la formation médicale » et de ne pas créer de fracture entre générations de praticiens.
L’UFML, par la voix de son président Jérôme Marty, a été plus radicale : « Sans choc d’attractivité, la fuite des libéraux se poursuivra », dénonçant un exercice devenu « économiquement intenable » avec le gel tarifaire. D’autres auditions ont mis en avant la réalité des urgences. Mathias Wargon, chef de service à l’hôpital Delafontaine, a ainsi décrit « un système où 70 % des passages aux urgences pourraient être traités en ville, mais où les libéraux sont découragés par la surcharge et le manque de reconnaissance ».
Des associations de patients ont également été entendues, insistant sur les conséquences du renoncement aux soins : délais d’attente prolongés, perte de suivi en santé mentale et ruptures de parcours en périnatalité. Ces voix ont renforcé le constat partagé par les élus locaux auditionnés, qui dénoncent une fracture territoriale grandissante et appellent à un rôle plus affirmé des communes dans la planification de l’offre de soins.
Ces débats se superposent aux autres dossiers brûlants : gel des tarifs des consultations, loi infirmière sur les compétences et négociations conventionnelles en cours. Pour les libéraux, le rapport Rousset est donc perçu à travers un prisme plus large, celui de la dégradation continue de leurs conditions d’exercice et du déséquilibre croissant entre l’hôpital public et la médecine de ville.
Et maintenant ?
Pour les libéraux, le rapport Rousset ouvre des pistes concrètes pour redéfinir l’équilibre entre autonomie professionnelle, délégation de tâches et gouvernance territoriale. Il trace un horizon susceptible de revitaliser sensiblement l’exercice libéral et d’améliorer l’accès aux soins pour les patients. Mais sa réussite dépendra d’un financement adéquat et d’une mise en œuvre politique forte. Or, dans le contexte actuel de contraintes budgétaires et de tensions sociales, cette traduction concrète reste très peu probable.
Pour les professionnels de santé, l’enjeu est donc double : suivre de près l’évolution politique de ces propositions, et s’impliquer localement pour peser sur leur application. Car c’est dans la capacité des praticiens à faire entendre leur voix que se jouera la portée réelle de ce rapport, entre espoir de réforme structurelle et risque de rendez-vous manqué.
Descripteur MESH : Santé , Médecins , Infirmiers , Médecins généralistes , Soins , Médecine , Urgences , Permanence des soins , Politique , Patients , France , Risque , Voix , Pression , Temps , Médecine générale , Contrats , Santé mentale , Rôle , Suède , Sécurité , Charge de travail , Investissements , Sécurité sociale , Budgets , Lettre , Autonomie professionnelle , Face , Hôpitaux , Femmes , Traduction , Travail , Étudiants , Secteur privé , Lumière , Apprentissage , Orientation , Diagnostic , Rupture , Choc