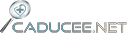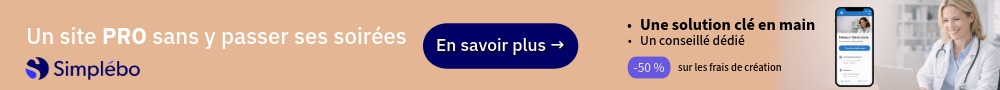Sensibilisation nationale au don de gamètes
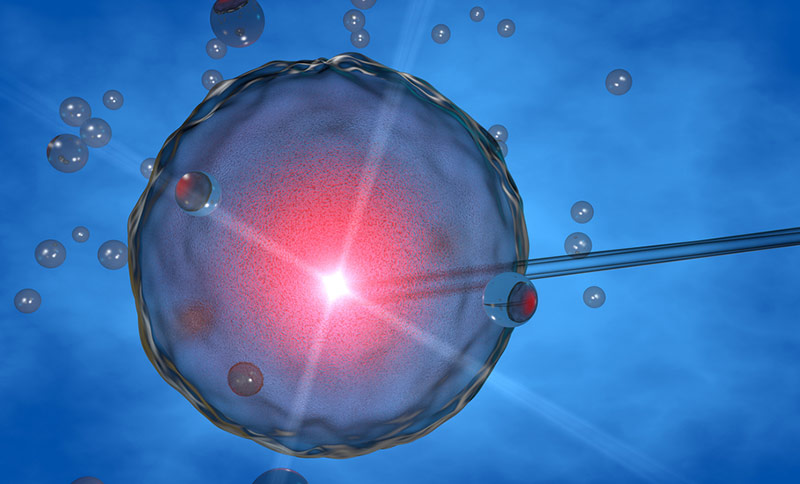
! « Donneur de bonheur » : une campagne positive qui invite à réfléchir au don de gamètes
En novembre 2014, l’Agence de la biomédecine lance une campagne nationale pour encourager les dons de spermatozoïdes et d’ovocytes et inciter chacun à se projeter comme donneuse ou donneur potentiel. Cette nouvelle campagne vise à augmenter les recrutements pour satisfaire les besoins de tous les couples infertiles devant recourir à une Assistance médicale à la procréation (AMP) avec don de gamètes.
L’Agence de la biomédecine souhaite aussi renforcer l’information des professionnels de santé, qui constituent un relais clé pour faire connaître le don de gamètes et répondre aux questions du public sur ce geste de solidarité qui reste encore méconnu.
A la fois simple et sans détour, la nouvelle campagne met en avant la grande valeur du gamète, un « cadeau » de taille, pourtant modeste.
Elle exprime la gratitude envers le « donneur de bonheur » pour son acte solidaire et unique. Elle permet aussi au public de mieux se représenter ce qu’est un gamète.
Avec la proximité des fêtes de fin d’année, la thématique du cadeau et de la parentalité devrait rencontrer un écho particulier. Diffusée sous forme d’annonces dans le Monde et Direct Matin, la campagne se déclinera également en bannières sur internet, en affiches et en brochures d’information po les professionnels de santé.
Soucieuse d’inciter le public à s’engager dans une démarche dont il comprend parfaitement les enjeux et les règles, l’Agence de la biomédecine propose deux sites internet de référence - dondovocytes.fr et dondespermatozoides.fr - et un numéro vert (0 800 541 541) dédié à l’information sur le don de gamètes.
Faire un don de gamètes est possible pour les femmes entre 18 et 37 ans, et les hommes entre 18 et 45 ans, en bonne santé et ayant déjà eu un enfant1. Il est réalisé dans des établissements de santé autorisés par les ARS, sur avis de l’Agence de la biomédecine, pour cette activité. Il est soumis aux trois principes éthiques communs à tous les dons issus du corps humain : libre consentement au don, anonymat et gratuité.!
Objectif : assurer l’autosuffisance de la France en dons de gamètes
L’importante mobilisation des professionnels de l’AMP et des pouvoirs publics sur le don d’ovocytes commence à porter ses fruits, notamment grâce à l’autorisation de nouveaux centres de don, l’augmentation du financement de l’activité et les actions d’information de l’Agence. Toutefois, même si elle progresse, l’activité du don d’ovocytes reste insuffisante au regard des besoins. L’attente d’ovocytes peut durer plusieurs années, occasionnant pour les couples des pertes de chance d’obtenir une grossesse.
La situation du don de spermatozoïdes est moins critique mais la vigilance s’impose. Depuis 2011, le recrutement des donneurs marque le pas. Cette situation, qui est suivie par l’Agence et par les professionnels, accroît le risque, pour certains couples infertiles, de rencontrer des difficultés pour bénéficier d’un donneur compatible avec certaines de leurs caractéristiques physiques et biologiques.
Le Pr Dominique Royère, qui dirige l’activité Procréation, embryologie et génétique humaine à l’Agence de la biomédecine, souligne que « l’amélioration de l’accès aux dons de gamètes constitue une priorité stratégique de l’Agence de la biomédecine, inscrite dans son Contrat d’objectifs et de performance 2012-2015 ». Pour le Dr Françoise Merlet, médecin en charge de l’AMP à l’Agence, « un objectif de 900 donneuses et de 300 donneurs par an permettrait de répondre aux besoins et d’assurer la diversité de profils requise pour apparier au mieux donneurs et receveurs. Tendre vers une autosuffisance permettrait de réduire le recours à des soins à l’étranger qui, indépendamment des contraintes que cela impose aux couples, n’est pas toujours en mesure d’apporter la même garantie de qualité et de sécurité sanitaire que les soins pratiqués en France. »
En France, le don de gamètes est réservé aux couples composés d’un homme et d’une femme en âge de procréer, mais qui ne peuvent pas réaliser leur désir d’enfant pour cause d’absence ou de défaillance des gamètes chez l’homme ou chez la femme, ou pour éviter la transmission d’une maladie grave à l’enfant ou à l’autre membre du couple.
Les chiffres clés de l’AMP avec don de gamètes en 2012
• En 2012, 422 femmes ont fait un don d’ovocytes pour près de 800 fécondations in vitro pour des couples. 164 enfants sont nés suite à une AMP faisant intervenir un don d’ovocytes. Au 31 décembre 2012, 2 110 couples étaient inscrits comme étant en attente d’un don d’ovocytes (contre 1723 en 2011 et 1 238 en 2010).
• Cette même année, 235 hommes ont donné des spermatozoïdes ; ils étaient 231 en 2011 et près de 300 en 2010. 1 141 enfants sont nés suite à une AMP avec don de spermatozoïdes
Les professionnels de santé, partenaires clés de l’information du public
Au quotidien, l’Agence de la biomédecine œuvre en étroite collaboration avec les sociétés savantes, les praticiens des centres de don et d’AMP et les ARS à améliorer la répartition territoriale de l’activité de don de gamètes et à renforcer la qualité des pratiques.
Pour l’information du public, tous les professionnels de santé, qu’ils soient praticiens ou sages-femmes exerçant en ville ou au sein des établissements de santé, sont des relais indispensables pour renforcer la confiance dans des activités de don qui restent méconnues et pour répondre aux questions de futurs donneurs. A l’occasion de la campagne de 2014, elle met également à disposition des professionnels de santé ses nouvelles affiches et brochures pour leurs salles d’attente et leurs consultations (commande possible sur le site de l’Agence de la biomédecine).
Des parcours médicalement et juridiquement encadrés pour les donneurs et les couples receveurs
Pour certains couples confrontés à une difficulté pour concevoir, le don de gamètes est la seule alternative qui leur permettrait de vivre une grossesse et de donner naissance à un enfant.
Bénéficier de ce don est possible, si l’un des deux membres du couple, bien qu’en âge de procréer, est dans l’incapacité de produire des gamètes aptes à la fécondation, que cette incapacité soit naturelle, ou consécutive au traitement stérilisant d’une maladie grave. Ce don peut également être réservé à des couples risquant de transmettre une maladie génétique grave à leur futur enfant.
Dans tous les cas, il revient à l’équipe médicale qui suit le couple de poser l’indication pour un don de gamètes, lorsqu’il s’avère nécessaire.
Don d’ovocytes – don de spermatozoïdes : Une solution accompagnée médicalement et encadrée juridiquement
Pour être donneuse d’ovocytes ou donneur de spermatozoïdes, il faut être en bonne santé, avoir entre 18 et 37 ans pour les femmes et entre 18 et 45 ans pour les hommes, et avoir déjà eu un enfant.
Pour les hommes et les femmes n’ayant pas eu d’enfant, la possibilité du don est mentionnée dans la loi de bioéthique votée en 2011. Le décret d’application n’étant pas encore publié, les centres pratiquant le don de gamètes ne peuvent accueillir actuellement que des candidats au don ayant déjà eu un enfant.
Pour faire un don d’ovocytes, la future donneuse doit contacter un des 30 centres d’Assistance médicale à la procréation pratiquant ce don, au sein d’établissements de santé autorisés par les Agences régionales de santé, sur avis de l’Agence de la biomédecine.
Le futur donneur de spermatozoïdes peut quant à lui contacter un des 27 centres spécialisés (publics ou privés à but non lucratif) chargés du recueil, du traitement et de la cession de spermatozoïdes en vue d’un don, également au sein d’établissements de santé autorisés par les Agences régionales de santé, sur avis de l’Agence de la biomédecine.
Chacun de ces 2 dons est un acte fort de solidarité, réclamant un engagement personnel à la suite d’une décision mûrement réfléchie.
! Le don en pratique
Le don d’ovocytes ou de spermatozoïdes implique un parcours comprenant un certain nombre de démarches et de rendez-vous médicaux qui s’échelonnent sur plusieurs semaines.
Pour faciliter le suivi du donneur potentiel, l’équipe médicale définit avec lui la période la plus favorable pour le don en fonction de son emploi du temps personnel, familial et professionnel et de l’organisation du centre.
La préparation au don compte trois étapes :
Qu’il s’agisse d’une future donneuse ou d’un futur donneur, la phase préparatoire au don est globalement identique.
• L’information : une première consultation est organisée avec l’équipe médicale afin d’expliquer au futur donneur l’ensemble des modalités pratiques du don, et lui permettre de poser toutes les questions relatives au don, y compris la contraception, les contraintes et les risques éventuels pour le don d’ovocytes. Plusieurs rencontres peuvent être programmées pour mener à bien le projet de don, en tenant compte du niveau de connaissance du futur donneur, de son besoin de réflexion,! A toutes les étapes du don, les membres de l’équipe médicale sont à la disposition du donneur, et s’il vit en couple, de l’autre membre du couple pour répondre à leurs questions.
• Le consentement : un formulaire de consentement au don doit être signé par le candidat au don, ainsi que par son conjoint, s’il vit en couple. Les deux membres du couple sont ainsi pleinement impliqués dans la réflexion et la démarche du don.
• Les examens médicaux : lors de l’entretien médical, le futur donneur informe le médecin de son état de santé, de ses antécédents personnels et familiaux. Conformément aux bonnes pratiques d’AMP, tous les centres agréés pour le don d’ovocytes ou de spermatozoïdes, appliquent des règles de sécurité sanitaire en réalisant, pour chaque donneur, un bilan médical approfondi. Sont prévus notamment une consultation génétique et un caryotype (examen des chromosomes), qui peuvent être complétés par des examens supplémentaires. L’évaluation de l’état de santé des donneurs permet de mieux connaître leur fertilité au moment du don et d’éliminer toute contre-indication au don.
- Pour le don de spermatozoïdes, le bilan médical inclut des tests sérologiques (notamment
HIV, hépatites, cytomégalovirus).
- Pour le don d’ovocytes, des tests sérologiques sont aussi réalisés et complétés par des analyses biologiques (prise de sang) et cliniques (échographie pelvienne...).
Chaque donneur, et éventuellement son conjoint, peut rencontrer, à tout moment, un psychologue ou un psychiatre.
Cet entretien représente un temps de parole libre et propice à la réflexion sur la démarche du don dans un cadre neutre (ni famille, ni amis) et personnalisé. Il est recommandé et peut être renouvelé à la demande.
Le don de spermatozoïdes : le recueil et le traitement du sperme
• Le premier recueil : il permet de vérifier les caractéristiques des spermatozoïdes et l’absence d’infection. Il peut éventuellement avoir lieu lors du premier rendez-vous.
• La congélation : les spermatozoïdes recueillis sont conditionnés dans des paillettes, puis congelés et transférés dans de l’azote liquide à une température de – 196°C. Un test de décongélation est ensuite pratiqué sur l’une des paillettes afin d’apprécier la tolérance des spermatozoïdes au processus de congélation. A l’issue du premier recueil et en fonction de son résultat, le donneur est informé du nombre de recueils suivants à effectuer.
• Les recueils suivants : chaque recueil s’effectue par masturbation après 3 à 5 jours d’abstinence sexuelle. Le donneur est accueilli par un personnel habitué au don, qui met tout en œuvre pour que tout se passe simplement et discrètement. La salle pour le don est spécifiquement prévue à cet effet et garantit l’intimité.
Le donneur est libre de déterminer le jour et l’espacement des rendez-vous en tenant compte de l’organisation du centre. Le sperme est contrôlé à chaque recueil.
Six mois minimum après le dernier recueil de sperme, afin de tenir compte de la période d’incubation des virus, des tests sérologiques (tels que les hépatites, le VIH,!) sont à nouveau réalisés.
Le don d’ovocytes : la stimulation ovarienne et le prélèvement d’ovocytes
• La stimulation des ovaires : avant la phase de stimulation ovarienne, une ou plusieurs injections sont souvent prescrites pour mettre les ovaires au repos. La stimulation dure 10 à
12 jours et permet d’aboutir à la maturation de plusieurs ovocytes. Elle est généralement réalisée par la donneuse elle-même ou par une infirmière grâce à des injections sous-cutanées quotidiennes.
• Une surveillance attentive : pendant la période de stimulation, 3 à 4 prises de sang et/ou échographies ovariennes permettent d’évaluer la réponse au traitement. La stimulation est ainsi adaptée au fur et à mesure par le gynécologue qui suit la future donneuse. Cette surveillance permet également de fixer le jour et l’heure du prélèvement des ovocytes.
• Le prélèvement des ovocytes : il a lieu au cours d’une hospitalisation d’un jour, 34 à
36 heures après la dernière injection. Il s’effectue par voie vaginale sous contrôle échographique et sous analgésie ou anesthésie. La donneuse peut ensuite quitter l’hôpital, à condition d’être accompagnée.
A l’issue du don, l’équipe médicale et paramédicale propose aux donneuses un suivi de leur état de santé. Comme toutes les autres femmes, il est recommandé qu’elles consultent régulièrement un médecin pour leur suivi gynécologique.
Tous les frais occasionnés par le don sont entièrement pris en charge sur justificatifs. Il peut arriver que la donneuse ait à avancer certains frais. L’équipe médicale et paramédicale l’accompagne dans ses démarches de remboursement.
Après le don d’ovocytes
Dans les heures ou les jours qui suivent le prélèvement, la donneuse peut ressentir une sensation de pesanteur ou des douleurs pelviennes et constater de légers saignements. Ces effets secondaires sont liés à la fois à la stimulation et au prélèvement. Ils sont sans gravité et ne durent pas.
Dans certains cas, ces effets indésirables peuvent persister ou s’intensifier en raison d’une réponse excessive des ovaires à la stimulation (syndrome d’hyperstimulation)2. Dans des cas très exceptionnels, l’hyperstimulation est plus sévère et se traduit par des troubles digestifs (douleurs abdominales, constipation) et parfois une gêne respiratoire. Ces signes doivent conduire la donneuse à contacter sans attendre le centre qui l’a suivie pour le don ou un service d’urgences. Elle sera immédiatement prise en charge.
D’autres complications peuvent être liées au geste chirurgical de prélèvement (hémorragie, infection, problème anesthésique, !), mais elles sont rarissimes.
Les données disponibles permettent d’affirmer que les traitements liés au don d’ovocytes n’ont pas de conséquence à long terme. Ils ne diminuent pas les chances de grossesse ultérieure et n’avancent pas l’âge de la ménopause.
Le don d’ovocytes est une démarche maîtrisée depuis près de 30 ans, dont le risque pour la santé est aujourd’hui extrêmement faible.
Parcours des couples receveurs: « retrouver l’espoir d’être parent »
Le don d’ovocytes, côté receveur
Le don d’ovocytes est proposé aux femmes en âge de procréer mais infertiles. L’infertilité médicalement avérée est due à l’incapacité de produire des gamètes aptes à la fécondation, que cette incapacité soit naturelle, ou consécutive au traitement stérilisant d’une maladie grave. Ce don peut également être proposé à des couples risquant de transmettre une maladie génétique grave à leur futur enfant. Les receveuses doivent être en capacité de mener à bien une grossesse (état de santé général, utérus). C’est leur gynécologue qui les met en contact avec un confrère exerçant dans un centre d’Assistance médicale à la procréation spécialisé.
Une équipe médicale pluridisciplinaire composée notamment de cliniciens, biologistes et psychologues accompagne le couple tout au long de son parcours. Le délai moyen pour bénéficier d’un don d’ovocytes, pour lesquels les critères d’appariement entre la donneuse et la receveuse correspondent, varie de 1 à 3 ans en fonction du nombre de donneuses qui se sont présentées dans le centre.
Le coût de l’Assistance médicale à la procréation avec don d’ovocytes est pris en charge par l’assurance maladie à 100 % au titre d’infertilité.
Pour bénéficier d’un don d’ovocytes, le couple suit plusieurs étapes :
• Consultations dans le centre spécialisé le plus proche : le couple rencontre un médecin chargé de l’informer et de répondre à toutes ses questions sur le déroulement d’une AMP avec don d’ovocytes et expliquer les critères pour en bénéficier. Le médecin prescrit un bilan médical complet pour la receveuse, mais également des examens pour le conjoint, notamment pour évaluer sa fertilité (examen de sperme).
En fonction des résultats médicaux et du respect des critères légaux, le médecin confirme avec le couple l’orientation vers le don d’ovocytes lors d’une deuxième consultation.
• Le consentement : préalablement au don, les deux membres du couple doivent rencontrer un notaire ou le président du Tribunal de grande instance pour être informés sur les conditions de la filiation dans le cadre d’une conception avec tiers donneur, et donner leur consentement.
• La préparation de la fécondation : lorsque la donneuse est identifiée, la receveuse reçoit un traitement simple pour préparer son utérus à recevoir le ou les embryons issus de la fécondation des ovocytes de la donneuse par les spermatozoïdes de son conjoint. Le recueil du sperme du conjoint se fait le jour du prélèvement ovocytaire de la donneuse. Dans certains cas, le sperme peut être recueilli préalablement et conservé par congélation.
• La fécondation : dès leur recueil, les ovocytes sont mis en fécondation au laboratoire avec le sperme, soit par fécondation in vitro classique (FIV) soit par micro-injection (ICSI)3.
• Le transfert d’embryons : si la fécondation a réussi, la receveuse se rend au centre spécialisé qui la suit pour le transfert embryonnaire.
Si le nombre d’embryons obtenus est supérieur au nombre d’embryons transférés, ils pourront être congelés pour un transfert ultérieur, soit après échec de ce premier transfert soit pour un projet de deuxième enfant.
Le don de spermatozoïdes, côté receveur
Le don de spermatozoïdes s’adresse à des couples en âge de procréer et ne pouvant pas avoir d’enfant pour diverses raisons : absence de spermatozoïdes ; spermatozoïdes inaptes à la fécondation ; spermatozoïdes détruits par le traitement utilisé pour soigner une maladie (chimiothérapie par exemple) ; risque de transmission d’une maladie génétique à l’enfant par le couple ; risque de transmettre une maladie grave à l’enfant ou à la conjointe par l’homme.
Pour bénéficier d’un don de spermatozoïdes, le couple suit plusieurs étapes :
• Le diagnostic d’infertilité masculine : le couple est pris en charge dans le cadre d’une consultation pour infertilité chez son gynécologue. Une phase exploratoire de l’infertilité des deux membres du couple est engagée. Des examens non invasifs sont prescrits, comme le spermogramme. Les causes possibles d’infertilité masculine sont recherchées dans l’histoire familiale, médicale et environnementale de l’homme, car il existe des cas d’infertilité transitoire et réversible.
Une fois le diagnostic posé et annoncé, le gynécologue informe le couple des perspectives qui s’offrent à lui, parmi lesquelles le don de spermatozoïdes. Si le couple souhaite en savoir plus sur cette solution, le gynécologue l’adresse à un centre d’assistance médicale à la procréation et à un centre de conservation du sperme, en majorité des CECOS (Centre d’Etude et de Conservation des Œufs et du Sperme humain).
• La prise en charge du couple par un centre de conservation du sperme : quel que soit le parcours du couple, le passage par un centre de conservation du sperme est obligatoire dans le cas d’une AMP avec don de spermatozoïdes.
• L’accueil des couples : il est effectué par un médecin lors d’un entretien approfondi. Ce rendez-vous permet d’examiner à nouveau l’anomalie du sperme de l’homme du couple ; il permet également d’expliquer au couple les modalités du don de spermatozoïdes et d’inscrire le couple en liste d’attente. A la fin du premier entretien, une date est communiquée au couple pour un prochain rendez-vous en fonction du délai nécessaire pour trouver un donneur compatible. Ce délai varie d’un centre à l’autre en fonction du stock de paillettes disponibles dans le centre mais aussi des contraintes d’appariement4 des couples.
• La programmation de l’AMP : elle est envisagée lorsqu’un donneur est identifié pour le couple. En amont de l’insémination, la receveuse reçoit en général un traitement de stimulation ovarienne.
• L’insémination artificielle avec sperme de donneur : en vue de la tentative, le conjoint vient chercher la ou les paillettes contenant les spermatozoïdes du donneur. En fonction de la technique d’AMP choisie, il les dépose au cabinet du gynécologue ou au laboratoire d’AMP autorisé pour les préparer avant l’insémination ou la fécondation in vitro.
En cas de fécondation in vitro (classique ou avec ICSI – injection intra-cytoplasmique de spermatozoïdes) avec sperme de donneur, elle est systématiquement pratiquée dans un centre d’AMP autorisé, par des praticiens compétents.
Un maximum de six inséminations artificielles et de 4 fécondations in vitro est pris en charge par la sécurité sociale avant le 43ème anniversaire de la receveuse.
Sur le plan médical, une équipe pluridisciplinaire de professionnels composée notamment de cliniciens, biologistes et psychologues accompagne chaque couple tout au long de son parcours d’AMP avec don.
Don de gamètes : son encadrement juridique en France
Comme tout don issu du corps humain (organes, moelle osseuse,!), les dons de spermatozoïdes et d’ovocytes relèvent de la loi de bioéthique.
Lors de la dernière révision de la loi en juillet 2011, le législateur a réaffirmé la finalité médicale de l’Assistance médicale à la procréation (AMP), et notamment du don de gamète : l’AMP a pour objet de remédier à l’infertilité médicalement diagnostiquée d’un des membres du couple ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie particulièrement grave. Ce couple doit être composé d’un homme et d’une femme en âge de procréer.
La loi a confié à l’Agence de la biomédecine l’encadrement des activités liées à l’Assistance médicale à la procréation (AMP) et au don de gamètes.
Un encadrement juridique stable
En France, le don de gamètes obéit à des principes éthiques constants, conformes à ceux qui régissent notre droit de la santé et du corps humain : anonymat, gratuité et libre consentement.
• Le don est anonyme : donneuses et donneurs ne peuvent pas connaître l’identité des couples receveurs ; de même, ces derniers ne peuvent pas connaître l’identité de la personne qui a réalisé le don de gamètes dont ils ont bénéficié.
Le nombre d’enfants issus du don de gamètes d’un seul et même donneur est limité par la loi à 10. Les probabilités de consanguinité pour les générations futures sont donc statistiquement infimes. La loi précise également qu’aucune filiation ne pourra être établie entre l’enfant issu du don et le donneur ou la donneuse. Cet enfant est celui du couple qui l’a désiré ; sa famille est celle dans laquelle il est né.
• Le don est gratuit : toute rémunération en contrepartie d’un don de gamètes est strictement interdite en France. Toutefois, les donneurs bénéficient de la prise en charge des frais occasionnés par le don, aidés dans leur démarche de remboursement par le centre dans lequel ils réalisent leur don.
Le caractère altruiste du don et l’absence de motivation financière incitent le futur donneur à répondre sincèrement lors de l’entretien médical, dans son intérêt et celui du couple receveur sur le plan médical.
• Le don est volontaire, librement consenti : le médecin du centre de don est chargé d’informer le donneur sur les modalités de prise en charge ; pour la donneuse, il doit également lui expliquer la technique mise en œuvre, notamment les risques et les contraintes de la stimulation hormonale et du prélèvement d’ovocytes.
Les donneurs signent un consentement écrit, sur lequel il est possible de revenir à tout moment et ce jusqu’à l’utilisation du don. Celui-ci est également signé par l’autre membre du couple, si la donneuse ou le donneur vit en couple.
Les conditions légales pour devenir donneur
Pour être donneuse d’ovocytes ou donneur de spermatozoïdes, il faut être en bonne santé, avoir entre 18 et 37 ans pour les femmes et entre 18 et 45 ans pour les hommes.
Ces limites d’âge ont été définies par les professionnels de santé pour deux raisons : ne présenter aucun risque pour les deux parties concernées ; garantir un niveau de fertilité suffisant chez les futurs candidats au don ; au-delà la fertilité naturelle et la capacité à produire des gamètes de qualité déclinent.
Les donneuses ou les donneurs doivent avoir déjà eu un enfant. Pour les femmes et les hommes n’ayant pas eu d’enfant, la possibilité du don est mentionnée dans la loi votée en juillet 2011. En attendant la publication du décret d’application, les centres pratiquant le don de gamètes ne peuvent accueillir que des femmes et des hommes déjà parents.
et pour bénéficier d’un don de gamètes
Le don d’ovocytes peut être proposé aux femmes en âge de procréer en cas d’absence d’ovocytes ou d’ovocytes inaptes à la fécondation, ou risquant de transmettre une maladie génétique grave. Les receveuses doivent être en capacité de mener à bien une grossesse (état de santé général, utérus conforme). C’est leur gynécologue qui les met en contact avec un confrère exerçant dans un centre spécialisé.
Le don de spermatozoïdes s’adresse à des couples en âge de procréer et ne pouvant avoir d’enfant suite à des cas d’infertilité masculine due à diverses raisons : absence de production de spermatozoïdes, spermatozoïdes inaptes à la fécondation, spermatozoïdes détruits par le traitement utilisé pour soigner une maladie (chimiothérapie par exemple), risque de transmission par le couple d’une maladie génétique à l’enfant, risque de transmission par l’homme d’une maladie grave à l’enfant ou à sa conjointe.
Les gamètes permettant de concevoir in vitro les embryons doivent provenir au moins de l’un des membres du couple. Il est interdit de concevoir des embryons à partir d’un double don de gamètes en France. Les deux membres du couple doivent être en vie au moment où la technique d’AMP avec tiers donneur est mise en œuvre. Les couples doivent être composés d’un homme et d’une femme en âge de procréer et qui, pour leur projet parental, doivent recourir à une AMP.
Le couple receveur doit donner son consentement au Président du Tribunal de grande instance ou à un notaire, ce qui interdit par la suite toute action pour établir ou contester la filiation, sauf si il est démontré que l’enfant n’est pas issu de l’Assistance médicale à la procréation ou si le consentement s’avère invalide. Ce consentement est révocable jusqu’au don. Le juge a aussi une mission de contrôle des conditions d’accueil que le couple est susceptible d’offrir à l’enfant à naître sur le plan familial, éducatif et psychologique. L’accueil d’embryons conçus dans ce cadre est subordonné à une autorisation du juge donnée pour trois ans au couple receveur.
La loi précise également qu’aucune filiation ne pourra être établie entre l’enfant issu du don et la donneuse ou le donneur. L’enfant est celui du couple qui l’a désiré ; sa famille est celle dans laquelle il est né.
Concernant les frais liés au don, les couples receveurs sont pris en charge à 100 % par l’Assurance maladie, après accord préalable du médecin conseil qui remet au patient une attestation pour obtenir cette prise en charge. Les frais couvrent l’ensemble des techniques d’AMP, dans la limite de six inséminations artificielles et de quatre tentatives de FIV réalisées avant l’âge de 43 ans pour la femme.
! L’encadrement spécifique des centres autorisés pour le don de gamètes
En France, le don de gamètes est réalisé par des praticiens spécialistes dans des centres autorisés par les Agences régionales de santé, après avis de l’Agence de la biomédecine.
Le don d’ovocytes se pratique dans des centres d’Assistance médicale à la procréation (AMP) au sein d’établissements de santé.
En France, 30 centres pratiquent cette activité. Ces centres sont chargés des activités cliniques comportant le prélèvement d’ovocytes (par ponction) en vue d’un don et des activités biologiques concernant la préparation, la conservation et la mise à disposition d’ovocytes en vue d’un don.
Le don de spermatozoïdes est confié à des praticiens exerçant dans des organismes publics ou privés à but non lucratif qui sont chargés du recueil, du traitement et de la cession de spermatozoïdes en vue d’un don.
En France, il existe 27 centres, majoritairement des CECOS (centres de conservation des œufs et du sperme humains).
Conformément aux bonnes pratiques édictées par l’Agence de la biomédecine en collaboration avec les professionnels de santé, tous les centres agréés pour le don d’ovocytes ou de spermatozoïdes appliquent des règles de sécurité sanitaire en réalisant, pour chaque donneur, un bilan médical approfondi.
Situation dans l’Union Européenne
Le don de gamètes est admis dans la plupart des pays européens ; un seul état membre de l’Union l’interdit à ce jour : il s’agit de l’Italie (loi de 2004). Toutefois, certains pays établissent une distinction entre le don d’ovocytes et le don de spermatozoïdes.
La raison fondamentale justifiant cette dissymétrie est le droit de l’enfant à avoir une seule et même mère génétique et gestationnelle. Dans ces pays :
- un ovocyte ne peut être fécondé artificiellement qu’en vue de l’implantation de l’embryon chez la femme à qui on l’a prélevé ;
- il est interdit de féconder davantage d’ovocytes que ceux pouvant être réimplantés
(sans embryons surnuméraires, le don d’embryons est de facto exclus).
Deux pays interdisent le don d’ovocytes, en plus de l’Italie : l’Allemagne et l’Autriche.
Les dons de spermatozoïdes et d’ovocytes ne font l’objet d’aucun encadrement réglementaire dans 5 pays - Chypre, Irlande, Lituanie, Malte et Pologne ; concernant le don d’ovocytes, deux pays viennent s’ajouter à cette liste : le Luxembourg et la Slovaquie. Dans chacun de ces pays, aucune filiation n’est envisageable entre le donneur et l’enfant né.
• Le don d’ovocytes et le principe d’anonymat
Comme en France, le don d’ovocytes est anonyme au Danemark, en Espagne, en Estonie, en Grèce, au Portugal, en République Tchèque et en Slovénie. Il est non anonyme en Finlande, au Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Slovénie. Cinq pays autorisent les deux types de dons (anonyme et non anonyme) : la Belgique, la Bulgarie, la Hongrie, la Lettonie et la Roumanie.
• Le don de spermatozoïdes et le principe d’anonymat
Le don de spermatozoïdes est autorisé dans la quasi-totalité des Etats membres de l’Union Européenne, sauf en Lituanie. Ce don se caractérise par des encadrements réglementaires très variés selon les pays.
Les pays autorisant le don de spermatozoïdes se répartissent en trois grandes catégories : tout comme en France le don est anonyme en Belgique, au Danemark, en Espagne, Estonie, Grèce, Hongrie, Portugal, République Tchèque et Slovaquie ; le don non anonyme concerne l’Allemagne, l’Autriche, la Finlande, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suède ; le don avec ou sans anonymat s’applique à la Bulgarie, la Lettonie et la Roumanie.
• La gratuité du don de gamètes
Le principe de la gratuité du don est largement répandu en Europe. Tous les pays prévoient le remboursement des frais engagés ou une compensation financière pour les frais de déplacement et d’hébergement, les absences professionnelles, les pertes de salaire éventuelles, à l’exception de la Bulgarie, de la Roumanie et de la Slovaquie.
A noter : le Royaume-Uni et l’Espagne pratiquent l’indemnisation, voire la rémunération des dons de gamètes.
• La limitation du nombre de naissances issues d’un(e) même donneur ou donneuse
L’utilisation des gamètes d’un même donneur fait également l’objet de recommandations
sur une éventuelle limitation du nombre de naissances pouvant être conduites avec les gamètes d’un même donneur. Tandis qu’en France le nombre d’enfants nés suite à un don est limité à 10, les limites introduites dans les législations pour les autres pays membres sont calculées tantôt en nombre d’enfants nés suite à un don - elles varient entre 2 et
25 enfants nés par donneur -, tantôt en nombre de familles pouvant être aidées par un seul donneur – les limites varient de 1 à 10 familles. Certains pays comme la Suède n’imposent aucune limitation.
Mieux comprendre le don d’ovocytes et le don de spermatozoïdes
Entretien avec le Dr Françoise Merlet, médecin responsable de l’Assistance médicale à la procréation à l’Agence de la biomédecine
Quels constats peut-on faire aujourd’hui sur les besoins en don de gamètes dans le cadre d’une AMP ?
Nous constatons que le nombre de demandes venant de couples infertiles qui ont besoin de recourir à une assistance médicale à la procréation avec don de spermatozoïdes ou d’ovocytes est assez stable ces dernières années.
Cependant il est difficile de satisfaire tous ces besoins. Les dons d’ovocytes sont en effet trop peu nombreux. Les dons de spermatozoïdes, quant à eux, doivent être maintenus à un niveau suffisant pour répondre aux besoins constants et également pour accroître la diversité des profils des donneurs.
Cette situation engendre des délais d’attente parfois très longs pour bénéficier d’un don de gamètes ; ce qui pénalise les couples concernés.
C’est tout l’intérêt de la nouvelle campagne lancée par l’Agence de la biomédecine : sensibiliser le grand public au don de gamètes et favoriser le recrutement de nouveaux donneurs afin d’aider les couples concernés à réaliser leur projet d’enfants.
Dans ce cadre, nos confrères professionnels de santé sont des partenaires clés car ils sont les premiers référents du public pour les questions de santé. Nous allons leur adresser des outils - affiches, brochures – qui pourront faciliter le dialogue avec leurs patients qui les questionneraient en vue de faire un don de gamètes. Parler du don de gamètes est indispensable pour favoriser le recrutement. Et si le temps leur manque, ils peuvent également indiquer nos 2 sites d’information www.dondovocytes.fr et www.dondespermatozoides.fr
Une prise en charge particulière est-elle prévue pour les donneuses d’ovocytes ?
Les médecins en charge du don sont particulièrement vigilants avec les donneuses en raison de la stimulation ovarienne et du prélèvement chirurgical. Ils informent toutes les futures donneuses sur les conditions du don, son déroulement, les contraintes et les risques qui y sont liés. Elles sont ensuite suivies tout au long du processus de don. En amont du don, les candidates aux dons d’ovocytes font l’objet d’un bilan de santé général et gynécologique. Grâce à ce bilan très complet, les médecins déterminent si ces femmes peuvent suivre le protocole de don, sans prendre de risque pour leur santé.
Pour pouvoir donner leurs ovocytes, les donneuses suivent une stimulation ovarienne pendant 10 à 12 jours puis les ovocytes sont prélevés par geste chirurgical. Dans les heures ou les jours qui suivent le prélèvement, la donneuse peut ressentir une sensation de pesanteur ou des douleurs pelviennes et constater de légers saignements. Ces effets secondaires sont liés à la fois à la stimulation et au prélèvement. Ils sont sans gravité et ne durent pas.
Les complications, si elles apparaissent, sont liées à ces deux étapes du processus de don. Mais elles sont très rares. Un syndrome d’hyperstimulation ovarienne peut survenir. Le plus souvent, il se manifeste par une gêne ou des douleurs abdominales, des nausées, des vomissements, une diarrhée, une augmentation de la taille des ovaires. Comme tout geste chirurgical, la ponction ovarienne peut entraîner des complications anesthésiques, hémorragiques ou infectieuses.
Depuis la mise en place du dispositif national d’AMP Vigilance7, aucun incident grave n’a été déclaré à l’Agence de la biomédecine. En 2012, sur 422 donneuses prélevées, un seul cas d’hyperstimulation8 simple a été déclaré, ce qui est rassurant.
Il faut savoir que la stimulation ovarienne des donneuses est réalisée avec la plus grande prudence. En France, nous ponctionnons en moyenne 10 ovocytes par donneuse, comme pour les femmes en FIV, alors qu’elles sont plus jeunes et qu’elles réagissent mieux au traitement.
Enfin, les traitements liés au don d’ovocytes n’ont pas de conséquence à long terme. Ils ne diminuent pas les chances de grossesse ultérieure et n’avancent pas l’âge de la ménopause.
Les donneuses bénéficient-elles d'un suivi médical particulier après leur don ?
Tout à fait, et d’autant plus que ce suivi médical après un don d’ovocytes est prévu par la loi.
À l’issue du don, les équipes médicales des centres d’AMP se tiennent à la disposition des donneuses à tout moment, si elles le jugent nécessaire.
Au-delà même des centres, les donneuses se tournent aussi souvent vers leur médecin de ville comme beaucoup de femmes pour leur suivi gynécologique. Les centres d’AMP et l’Agence de la biomédecine sont à l’écoute des professionnels de santé.
Après le don, des frais restent-ils à la charge des donneurs ?
Comme pour tous les dons d’éléments du corps humain, la loi prévoit la prise en charge des frais occasionnés par le don d’ovocytes et de spermatozoïdes afin que les donneurs ne supportent pas le coût de la procédure. La loi prévoit ainsi une neutralité financière du don. Il peut arriver que les donneuses et les donneurs aient à avancer certains frais (déplacements, hébergement, etc.). L’équipe médicale est disponible pour les aider dans leurs démarches de remboursement sur la base de leurs justificatifs.
Le don de gamètes est un acte altruiste et généreux qui est gratuit en France. La loi interdit toute rémunération en contrepartie du don d’ovocytes. Cette gratuité permet notamment d’éviter que les donneurs ou les donneuses multiplient les dons dans différents lieux pour des motivations uniquement financières ou qu’ils cachent des informations médicales d’importance pour garantir leur règlement. Ce type de pratiques pourrait engendrer des risques pour la santé des donneuses ou pour l’issue du don.
Quelles sont les perspectives d’évolution du don d’ovocytes ?
Plusieurs évolutions sont attendues et devraient avoir un impact positif prochainement.
Tout d’abord la mise en œuvre de la vitrification ovocytaire dans le cadre du don d’ovocytes. Il s’agit d’une nouvelle technique de congélation très rapide des ovocytes autorisée par la loi de bioéthique de 2011. Elle permet de dissocier dans le temps le prélèvement des ovocytes chez la donneuse, de l’attribution des ovocytes aux couples receveurs. La contrainte de synchronisation des cycles de la donneuse et des receveuses est ainsi évitée. Cette technique est en cours de mise en place dans les centres.
On peut imaginer que se constitueront dans les années à venir des banques d’ovocytes dédiées au don à l’instar des banques de sperme.
Par ailleurs, la loi de bioéthique de 2011 prévoit d’ouvrir aux personnes n'ayant pas encore d'enfant la possibilité de faire un don d'ovocytes ou de spermatozoïdes. L'application de cette loi est en attente de la parution d'un décret.
Quels sont les besoins de dons de gamètes en France ?
Notre premier objectif est avant tout de répondre aux besoins et donc d’augmenter les dons de spermatozoïdes et d’ovocytes.
Nous essayons, en accord avec le couple receveur, de proposer des gamètes qui ont des caractéristiques proches de ce couple. Nous constatons que la plupart des donneurs et donneuses actuelles sont de type « caucasien ». Pour répondre à la demande de couples receveurs qui ont d’autres origines - asiatique et africaine par exemple -, nous avons en effet besoin d’enrichir et de diversifier les profils des donneurs et des donneuses par rapport à ces morphotypes.
Quels sont les moyens mis en place pour améliorer l’offre et la prise en charge du don d’ovocytes sur le plan national ?
L’insuffisance des moyens dédiés à cette activité a été constatée par l’IGAS en 2011. En outre, l’activité de don d’ovocytes est très chronophage pour les professionnels.
En s’inspirant de ce qui a été proposé dans le rapport de l’IGAS9, le ministère de la santé et l’Agence de la biomédecine ont exploré en 2011 de nouvelles modalités de financement. Ainsi, plusieurs types de financement viennent soutenir l’activité réalisée : un forfait spécifique pour l’hospitalisation et la ponction d’ovocytes, une prise en charge à 100 % de actes médicaux (échographie, dosages hormonaux, !) et une dotation Mission d’Intérêt Général couvrant les charges de structure et permettant aux établissements de santé d’assurer la neutralité financière.
Cette juste reconnaissance financière de l’activité de don d’ovocytes, progressivement mise en œuvre depuis 2012, permet ainsi aux établissements, malgré des difficultés conjoncturelles, d’améliorer l’offre sur tout le territoire et de développer l’activité, à hauteur des besoins.
Que peut-on dire aux couples infertiles qui envisagent de se tourner vers l'étranger ?
Les activités d’Assistance médicale à la procréation (AMP) sont strictement encadrées en France. Les centres d’AMP sont spécifiquement autorisés pour la réalisation des actes d’AMP en lien avec la qualité et la sécurité des soins qui sont donnés ; ils sont soumis au respect des règles de bonnes pratiques et sont inspectés. Les activités sont évaluées annuellement par l’Agence de la biomédecine.
Le recours à des soins à l’étranger, y compris au sein de l’Union européenne, présente des contraintes pour les couples et n’est pas toujours en mesure d’apporter la même garantie de qualité des soins et de sécurité sanitaire qu’en France.
Les couples qui se rendent à l’étranger doivent garder en tête qu’il est primordial qu’ils conservent leur dossier médical complet. Ce dernier contient toutes les informations nécessaires à leur prise en charge dans les meilleures conditions possibles, y compris lors de leur retour en France.
Les différences médicales et sanitaires entre la France et l’étranger sont présentées sur le site www.procreationmedicale.fr.
Rôle et missions de l’Agence de la biomédecine
L’Agence de la biomédecine est un établissement public national créé par la loi de bioéthique du 6 août 2004.
Elle exerce ses missions dans un vaste domaine couvrant :
• les activités de prélèvement et de greffe d’organes, de tissus et de cellules souches hématopoïétiques ;
• les activités cliniques et biologiques d’Assistance médicale à la procréation ;
• les activités de diagnostic prénatal, préimplantatoire et génétique ;
• les activités de recherche sur les cellules souches embryonnaires et l’embryon humain.
Dans ses domaines de compétence, l'Agence de la biomédecine met tout en œuvre pour améliorer la qualité des soins proposés à chaque malade, dans le respect des règles de sécurité sanitaire, d'éthique et d'équité.
Autorité de référence sur ces questions, elle s’appuie sur l’expertise médicale, scientifique, juridique, éthique qu’elle a développée en son sein et en relation avec les professionnels de santé.
Les missions de l’Agence en matière d’Assistance médicale à la procréation
L’Agence de la biomédecine a pour objectif d’améliorer les conditions de prise en charge des couples concernés dans le respect des lois et des règles d’éthique, d’équité et de sécurité sanitaire.
• Les activités cliniques et biologiques d’AMP sont soumises à autorisations des établissements et des laboratoires concernés, le législateur ayant voulu garantir aux patients qu’elles soient exercées par des praticiens compétents, dans des structures qui ont déployé les moyens adaptés. Les autorisations des centres cliniques et biologiques d’AMP sont délivrées par les Agences régionales de santé qui s’appuient notamment sur les avis rendus par l’Agence de la biomédecine.
• L’Agence de la biomédecine délivre également les autorisations d’importation et d’exportation des cellules reproductrices (c'est-à-dire les gamètes : spermatozoïdes et ovocytes) ou de déplacement d’embryons afin de permettre à des couples de poursuivre leur projet parental s’il change de lieu de résidence à l’intérieur ou hors de nos frontières.
• L’Agence de la biomédecine met en œuvre un dispositif de vigilance en AMP. Il s’agit de recueillir et d’analyser les incidents survenant lors de l’utilisation à des fins thérapeutiques des gamètes, embryons et tissus germinaux et les effets indésirables chez les donneurs de gamètes ou chez les personnes qui ont recours à l’AMP. L’objectif est d’améliorer les pratiques et d’optimiser la sécurité des soins.
• L’Agence de la biomédecine élabore et fait évoluer, avec les professionnels, les recommandations et règles de bonnes pratiques, notamment en ce qui concerne l’AMP avec tiers donneur.
Fruit d’une interaction très forte entre l’Agence de la biomédecine et les professionnels de l’AMP, fondée sur l’échange et la confiance, la démarche d’évaluation et d’amélioration des pratiques est consensuelle. Mis en place par l’Agence de la biomédecine, dont il est une priorité, le registre national des fécondations in vitro (FIV) vise à la renforcer. Il consiste à recueillir les données des centres d’AMP portant sur chaque tentative de fécondation, dans le but d’analyser précisément chaque activité d’AMP (déroulement, conséquences sur la santé) et de mieux comprendre le parcours des couples, y compris en ce qui concerne le déroulement des grossesses obtenues.
L’envoi des données par les centres est obligatoire depuis 2010. Il est facilité par une application informatique développée par l’Agence de la biomédecine, permettant le transfert des fichiers ou la saisie en ligne.
En collaboration avec les professionnels et des instances comme l’assurance maladie, l’Agence de la biomédecine travaille à compléter cette approche pour évaluer l’impact des FIV sur la santé des enfants ainsi conçus. Jusqu’à présent, aucune différence n’a été observée dans la santé des enfants entre ceux conçus sans don et ceux avec don.
• Elle fait en sorte que les personnes porteuses de virus ou subissant des traitements stérilisants puissent accéder à l’Assistance médicale à la procréation.
• Elle analyse les raisons de la pénurie dans le cadre du don d’ovocytes afin de proposer des mesures correctives.
• L’Agence est également chargée de mettre en place un suivi de la santé des personnes ayant recours à l’Assistance médicale à la procréation et des enfants qui en sont issus, ainsi que des femmes donneuses d’ovocytes.
• La loi du 7 juillet 2011 confie à l’Agence de la biomédecine le soin de publier régulièrement les résultats de chaque centre d’AMP selon une méthodologie prenant notamment en considération les caractéristiques des patients et l’âge des femmes. Au vu de ces données, l’Agence peut diligenter des missions d’appui et de conseil.
• Enfin, elle assure l’information des couples qui s’engagent dans une démarche d’Assistance médicale à la procréation et celle du grand public sur le don d’ovocytes et de spermatozoïdes.
Pour remplir ces missions, l’Agence de la biomédecine s’appuie sur son conseil d'orientation, instance de réflexion éthique, de conseil et d’avis.
Descripteur MESH : Don , Spermatozoïdes , Santé , AMP , France , Maladie , Femmes , Ovocytes , Sperme , Fécondation , Génétique , Membres , Sécurité , Enfant , Bioéthique , Risque , Soins , In vitro , Hommes , Grossesse , Démarche , Personnes , Maladie grave , Transfert , Temps , Congélation , Cellules , Conseil , Corps humain , État de santé , Affiches , Patients , Rémunération , Roumanie , Fécondation in vitro , Famille , Éthique , Établissements de santé , Entretien , Slovaquie , Utérus , Brochures , Diagnostic , Syndrome , Bulgarie , Tissus , Tests sérologiques , République tchèque , Bonheur , Injections